Des barbelés dans la Sierra
|3. Crise de l'ancien système et nouvelle spécialisation (1950-1990)
Texte intégral
1Après les six années de gouvernement Lazaro Cardenas (1934-1940), la Réforme agraire est brutalement ralentie. L’équilibre des forces politiques favorise désormais l’initiative privée, c’est-à-dire le secteur des exploitations les plus capitalisées, par opposition au secteur ejidal issu de la Réforme agraire. Le secteur privé est alors considéré comme le seul capable de mener à bien la « modernisation » de l’agriculture. Pour cela, il faut ouvrir de nouvelles terres aux activités agricoles et pastorales et en laisser l’exploitation aux « entrepreneurs » agricoles (Tarrio Garcia, 1985). De grands barrages sont construits dans le cadre de la nouvelle politique dite « des bassins hydrographiques » à partir de 1947 tandis que les nouvelles lois de colonisation (1946) facilitent le défrichement des régions tropicales humides, l’installation de nouveaux ejidos et la formation de grands domaines d’élevage.
2Les grands travaux d'irrigation, le développement de l’industrie chimique et la proximité du marché nord-américain permettent une diffusion rapide des variétés de la « Révolution verte » (blé) et l’accroissement des surfaces consacrées aux cultures d’exportation. Les terres irriguées, le plus souvent confiées au secteur privé le plus capitalisé, sont au centre de ce processus de modernisation. L’agriculture pluviale et paysanne ne retient guère l’attention des pouvoirs publics, si ce n’est lorsqu’il s’agit de retarder l’explosion sociale et de parfaire le contrôle politique exercé sur la paysannerie par la poursuite de la Réforme agraire.
3Le renforcement de la division du travail s’accompagne également d’une spécialisation régionale accentuée qui marque les paysages agraires mexicains. Dans l’État du Michoacán, les cultures légumières ont envahi les vallées irriguées du nord ; le sorgho a partiellement remplacé le maïs sur les terres pluviales du Bajio ; l’avocatier s’est substitué aux pins et au maïs sur les versants du plateau tarasque. À l’ouest de la Sierra de Coalcomán, les cultures fruitières ont occupé les nouveaux périmètres irrigués de l’État de Colima. Au nord de la Sierra, la grande dépression des Terres Chaudes a été transformée par les travaux d’irrigation entrepris par la Commission du bassin du Rio Tepalcatepec. Près de 100 000 ha y ont été dotés d’infrastructure d’irrigation, consacrés surtout aux cultures d’exportation (coton, citron vert, melon, pastèque, etc.). Les Terres Chaudes sont aussi désenclavées par la construction de routes et de ponts.
4Comme la région de Coalcomán ne fait pas partie du bassin hydrographique du Rio Tepalcatepec, elle ne bénéficie pas directement de l’aménagement de la vallée, si ce n’est par l’ouverture des voies de communication. C’est au lendemain de la révolte des Cristeros et pour des raisons politiques évidentes que le projet de piste reliant Coalcomán à Apatzingán est mis en chantier. Le chemin est achevé en 1947 et la construction d’un pont sur le Rio Tepalcatepec permet d’accéder à Coalcomán en toute saison depuis 1952 (Cardenas, 1972). En outre, le développement de l’aviation légère et la multiplication des pistes d’atterrissage augmentent la mobilité des personnes et facilitent le petit commerce. Ainsi, la plupart des villages isolés de la Sierra de Coalcomán peuvent être rapidement reliés aux principales villes des alentours : Colima, Ciudad Guzman, Apatzingán, Uruapan et Morelia.
5Bien que reliée désormais au réseau routier national et désenclavée par les transports aériens, la Sierra de Coalcomán reste relativement isolée, dépourvue d’avantages comparatifs et sans possibilité d’irrigation. Est-elle maintenue à l’écart de la « modernisation agricole » et marginalisée ?
6De fait, le système agraire mis en place par les migrants installés à Coalcomán depuis la fin du xixe siècle se transforme profondément. Le pois chiche est infesté de maladies cryptogamiques et les terres ne sont plus labourées ; les marchés des deux principaux produits de la Sierra de Coalcomán – taureaux de dressage et porcs gras – s’effondrent. La plupart des productions disparaissent peu à peu, tandis que l’élevage naisseur devient progressivement l’activité dominante, le centre de gravité des systèmes de production. Cette nouvelle spécialisation de la région de Coalcomán s’accompagne du départ de la plus grande partie des métayers vers de nouveaux horizons, ainsi que d’une relance des accaparements de terres perpétrés au détriment des communautés indiennes de la côte.
LA SPÉCIALISATION VERS L’ÉLEVAGE NAISSEUR
L’élimination progressive de la plupart des activités de l’ancien système agraire
La maladie du pois chiche
7La crise du système agraire et sa transformation se manifestent d’abord par la maladie du pois chiche et du haricot noir due à l’infection des plantes par un champignon microscopique (l’Anthrachnose du pois chiche). Comme cette maladie cryptogamique détruit entièrement les plants, les surfaces emblavées en pois chiche et en haricot sont considérablement réduites en quelques années (1960-1965). La culture du pois chiche est même complètement abandonnée jusqu’à ces dernières années où elle réapparaît dans certaines exploitations.
8Avec l’abandon de cette culture, c’est un élément fondamental du système de culture attelée qui disparaît. On se souvient que le pois chiche intervenait en tête de rotation sur les terres labourées, précédant ainsi la culture du maïs. Contraints de délaisser la culture du pois chiche, les agriculteurs continuent néanmoins à semer du maïs sur les terres labourées, en effectuant le même travail du sol qu’auparavant : labour à la charrue en fin de saison des pluies (septembre) puis passage avec l’araire en octobre (qui correspond au sarclage de l’ancien pois chiche) et, enfin, troisième passage (charrue) au mois de mai pour préparer les semis de maïs. L’ancienne culture du pois chiche est donc remplacée, dans la rotation, par une véritable jachère qui permet de préparer le terrain à la culture du maïs. Le maintien des différentes phases de travail du sol après abandon du pois chiche met donc en évidence le véritable rôle que jouait ce dernier dans la rotation. Au rôle – relativement limité – de fournisseur d’azote s’ajoutait celui – décisif – de plante sarclée qui permettait un nettoyage efficace de la parcelle (adventices) et un ameublissement satisfaisant du sol. On pouvait préparer la culture du maïs (labour) sans attendre les premières pluies et donc semer immédiatement après leur arrivée. Après l’abandon du pois chiche, ces pratiques se maintiennent pendant quelques années avant d’être à leur tour délaissées. C’est la reproductibilité même du système de culture qui est alors atteinte.
- 1 D’après les recensements agricoles de 1950, 1960 et 1970, les rendements moyens obtenus dans la co (...)
9En effet, les labours de jachère augmentent la quantité de travail nécessaire à la culture du maïs sans permettre pour autant de maintenir le niveau de rendement. Dans le tableau vii, on retient le cas favorable d’une parcelle faiblement pentue pouvant être efficacement labourée à la charrue. Un seul passage de l’outil remplace les deux passages croisés de l’araire pour la préparation du champ avant les semis de pois chiche et de maïs. Il faut alors 49 journées de travail pour cultiver 1 ha de maïs. Aux deux hypothèses de rendement adoptées pour le maïs dans les tableaux iv et v (partie 2, p. 67), on en ajoute une troisième plus défavorable de 5 q/ha, qui rend compte de l’évolution probable des rendements1.
Tableau VII. Rendements et productivité du travail pour la culture du maïs après abandon du pois chiche

* Les quantités sont rapportées à la surface concernée par la « rotation » jachère/maïs (2 ha).
10La productivité du travail diminue donc fortement. En outre, la quantité de kilocalories produites par hectare dans l’hypothèse la plus favorable reste inférieure à celle produite par l’ancienne rotation pois chiche/maïs dans l’hypothèse la moins favorable (tabl. v, p. 92).
11Par ailleurs, et de l’avis même des agriculteurs, la généralisation de l’usage de la charrue sur les versants raides de la Sierra aurait accéléré l’érosion et précipité l’abandon de la culture attelée. Lorsque les terres étaient travaillées à l’araire, la moitié du terrain (chaque bande séparant deux sillons consécutifs) n’était pas remuée par le passage de l’outil, ces micro-terrasses constituant une protection efficace contre l’érosion. La charrue au contraire bouscule la totalité de la superficie et travaille plus profondément, parfois jusqu’à racler la roche mère toute proche. En quelques années, la terre pulvérisée est emportée et « il ne reste que la pierre ».
12L’abandon de la culture du pois chiche et l’érosion progressive des versants conduisent donc à la régression rapide de la culture attelée dans tous les ranchos de la Sierra de Coalcomán (tabl. viii). Mais les terrains abandonnés ne retournent pas à la friche pour autant : lessivés, indurés par le piétinement des animaux et parfois réduits à des affleurements de roches, les anciennes « terres à bœufs » se transforment en une sorte de steppe arbustive où seul le huizache (Acacia schaffneri) pousse car ses gousses sont appréciées du bétail, ses semences activées au cours du transit intestinal et disséminées par les animaux. Les seules terres encore labourées sont celles de la vallée de Coalcomán. Elles sont maintenant travaillées au tracteur (partie 4, p. 215).
Tableau VIII. Régression de la culture attelée dans la commune de Coalcomán 1950-1970

Sources : recensements agricoles de 1950 et 1970.
* Tous systèmes de culture confondus (culture attelée et sur brûlis).
** Union des éleveurs de Coalcomán, chiffre avancé pour 1987.
*** SARH, Distrito de Desarollo Rural no 083, Aguililla, moyenne 1980-1985.
13La crise de l’ancien système agraire commence donc par une crise conjoncturelle, celle de la culture du pois chiche. Mais ne nous y trompons pas. Une jachère soignée et l’utilisation plus systématique du guano de chauve-souris auraient permis le maintien de la culture attelée, au moins sur les parties les moins en pente de la Sierra. S’il n’en est rien, c’est que les conditions du développement de tels systèmes de culture ne sont plus réunies. Certains agriculteurs affirment qu’en négligeant les premiers labours de jachère, ils ont provoqué une diminution des rendements, entraînant l’abandon rapide de la culture. Pour d’autres, plus nombreux, c’est l’apparition des herbicides et des engrais chimiques qui les a conduits à délaisser les terres labourées, au profit du système de culture sur brûlis, alors facilité par ces nouveaux intrants. Mais les systèmes de culture avec labour n’auraient-ils pu bénéficier, eux aussi, de l’utilisation de ces nouveaux moyens de production ? Et la recherche agronomique n’aurait-elle pu mettre au point de nouvelles variétés de pois chiche résistantes à l’Anthrachnose ?
14La découverte d'une crise spécifique du pois chiche ne suffit donc pas à expliquer son abandon total et la régression si spectaculaire des terres labourées. Elle n’en constitue assurément qu’un élément.
L’évolution de la production de porcs gras
15La diminution des surfaces labourées se traduit bientôt par un effondrement de la production de pois chiche et une baisse importante de la production de maïs. Comme la consommation humaine de maïs ne peut être réduite (elle augmente même avec la croissance démographique), c’est la quantité de maïs distribué aux porcs qui diminue fortement, et donc le nombre de porcs engraissés chaque année. D’après les recensements agricoles de 1950 et 1970, cette baisse serait de près de 80 %, comme en témoigne le tableau ix.
Tableau IX. Évolution de la production de maïs et de porcs gras dans la commune de Coalcomán 1950-1970

Sources : recensements agricoles de 1950 et 1970.
16Les données des recensements concernant les porcs sont incertaines, mais une estimation simple confirme les mêmes tendances. Vers 1930, 1 500 familles produisaient chacune environ 5 t de maïs chaque année dans la commune de Coalcomán (partie 2, p. 67). 2 t étaient destinées à la consommation familiale, à la basse-cour et à l’âne, tandis que les 3 t restantes étaient consacrées à l’engraissement de cochons (par le métayer et surtout par le propriétaire). Nous avions alors estimé la production annuelle de porcs gras à 15 000 têtes. En 1970, la population rurale de la commune de Coalcomán est toujours de 1 500 familles environ car la croissance démographique a été anéantie par l’exode des métayers (dont on reparlera). En admettant que chaque famille ne produise plus que 3 t de maïs par an (c’est l’ordre de grandeur suggéré par le recensement de 1970) et que la consommation de la famille et de la basse-cour est la dernière sacrifiée, le surplus de maïs dégagé par chaque famille se réduit à 1 t de grains et il n’y a plus de pois chiche pour compléter la ration alimentaire des cochons. La quantité totale de grains disponible pour les porcs est alors de 1 500 t, ce qui permet d’engraisser 3 750 porcs si l’on distribue 400 kg à chacun d’eux (et non pas 300 kg comme c’était le cas lorsque la production de pois chiche était abondante). En réalité, cette production est probablement encore plus faible car la croissance urbaine du bourg de Coalcomán multiplie le nombre des improductifs : une partie du maïs excédentaire est vendue au bourg plutôt que distribuée aux cochons.
17La maladie du pois chiche, l’abandon progressif des terres labourées et la chute consécutive de la production de maïs semblent donc à l’origine de l’effondrement de la production de porcs gras. Pourtant, tout porte à croire que cette activité aurait connu une évolution identique si la production de maïs et de pois chiche s’était maintenue à un niveau élevé.
18En effet, les conditions de concurrence imposées par le marché ne laissent alors aucune chance à la production fermière de saindoux. L’évolution des habitudes alimentaires, en liaison avec l’urbanisation, et l’essor de la production mondiale d’oléagineux déclassent définitivement les graisses animales au profit des huiles d’origine végétale, produites dans de meilleures conditions de productivité. Si, en 1906, 1 kg de saindoux valait le prix de 20 kg de maïs dans le bourg de Coalcomán (partie 2, p. 67), il ne vaut plus qu’une douzaine de kilogrammes de maïs (pourtant lui même dévalué) cinquante ans plus tard et moins de 10 kg au début des années soixante-dix (sur le marché de Mexico).
19Dans la Sierra de Coalcomán, la production de saindoux se limite donc progressivement à la capacité de consommation de la population locale. Pour les familles les plus démunies, le cochon reste un recycleur de déchets domestiques irremplaçable et permet d’éviter toute dépense monétaire pour la consommation domestique de graisses. Le sacrifice du porc gras marque aussi les fêtes familiales les plus importantes ; tout le monde préfère encore le goût de haricots noirs frits au saindoux que celui donné par les huiles végétales.
20La dépréciation relative du prix du saindoux est encore plus marquée par rapport au prix de la viande de porc. Jusqu’en 1943, 1 1 de saindoux valait légèrement plus cher que 1 kg de viande de porc. Après cette date, le prix de la viande dépasse définitivement celui de la graisse pour s’établir à plus du double (fig. 25). Les marchés urbains absorbent des quantités considérables de viande de porc, tandis que la graisse devient un sous-produit dévalorisé.
Figure 25. Évolution comparée du prix (en pesos) de la viande de porc et du saindoux à Mexico (1927-1970).

Source : d'après les données de Inegi-lnah (1986) (voir annexe 7).
- 2 En 1960, six millions de porcs sont recensés au Mexique. Ils sont près de 10 millions en 1970 et 2 (...)
21Pour les agriculteurs de Coalcomán, une reconversion dans la production de viande de porc est impossible. Le maïs fournit une alimentation déséquilibrée, incapable de produire un animal conforme aux exigences nouvelles du marché. Il faudrait acheter des aliments concentrés et développer les races (Durok, Yorkshire) capables de valoriser au maximum ces nouveaux aliments. Quelques éleveurs mènent à bien ces transformations mais leur production ne peut en aucun cas dépasser la capacité de consommation du bourg de Coalcomán. Dès les années cinquante, la production nationale de viande porcine est assurée par le développement de grands centres porcicoles hors-sol comme celui de La Piedad dans le nord du Michoacán. Non seulement la production de porcs fermiers ne peut supporter la concurrence de cette production à grande échelle2, mais Coalcomán est aussi trop éloigné des porcheries d’engraissement pour se spécialiser dans les activités de reproduction et les approvisionner en porcelets ; activité réservée aux villages situés à proximité des centres d’engraissement ou dans les régions productrices de sorgho.
Les cultures irriguées
22Parmi les cultures irriguées, c’est la canne à sucre qui souffre le plus du développement des voies de communication routières et de la concurrence exercée par les grands bassins sucriers. Les gains de productivité enregistrés dans l’industrie sucrière provoquent une baisse relative du prix du sucre raffiné et la disparition de la plupart des petits moulins à canne de la vallée de Coalcomán. Actuellement, la totalité du sucre consommé dans le bourg de Coalcomán, et même dans les hameaux dispersés de la commune, est d’origine industrielle. Le prix des petits pains de sucre roux (cassonade) fabriqués artisanalement est deux fois plus élevé que le prix du sucre industriel vendu dans les épiceries locales, alors que le rapport de prix était inversé dans les années quarante. Ce nouveau rapport de prix fait du sucre roux fabriqué traditionnellement une sorte de produit de luxe (une confiserie) encore apprécié sur le marché local de Coalcomán. C’est pourquoi de petites parcelles de canne à sucre sont encore visibles çà et là dans les exploitations qui disposent d’une main-d’œuvre familiale importante (la productivité du travail n’ayant pas progressé). De plus, les extrémités des tiges et les cannes écrasées peuvent constituer une source importante de fourrage vers la fin de la saison sèche. Mais cette production de sucre roux reste strictement limitée par les capacités d’absorption du marché local.
23Tout autour du bourg de Coalcomán et le long des pistes qui convergent désormais vers le bourg, on peut observer de petites parcelles irriguées de cultures légumières ou fruitières. Là aussi, la croissance urbaine du bourg et la constitution d’un marché local – encore protégé de la concurrence des périmètres irrigués des régions voisines (dépression des Terres Chaudes, État de Colima) par plusieurs heures de routes montagneuses – ont permis le développement spontané de ces cultures spéculatives. C’est surtout vrai pour les produits pondéreux (pastèque, agrumes) dont le prix, sur le marché de Coalcomán, augmenterait du coût de transport s’il fallait les importer d’une autre région. Mais les parcelles sont très réduites et ces activités ne concernent qu’un très petit nombre de producteurs, jouissant d’une rente différentielle due à l’emplacement de leur parcelle sur le bord d’un chemin.
La production d’animaux de travail
24Outre la production de porcs gras, la Sierra de Coalcomán était également spécialisée dans la production de taureaux expédiés dans le centre du pays pour y être dressés et attelés. Cette activité connaît, elle aussi, une crise grave à partir de la fin des années quarante. Elle disparaît totalement en une vingtaine d'années.
25Une fois encore, pour comprendre les transformations agropastorales de la Sierra de Coalcomán, il faut s’intéresser à l’évolution du secteur agraire du Bajio, au centre du pays : c’est là que la plupart des animaux nés et élevés dans les ranchos de Coalcomán sont alors utilisés pour le travail de la terre. Mais en 1947, la politique nationale du « fusil sanitaire », adoptée sous la pression des États-Unis d’Amérique pour faire face à une épidémie de fièvre aphteuse, décime le troupeau bovin au centre du pays. Dans les régions plus isolées et moins bien contrôlées par l’armée, il est plus facile de dissimuler les troupeaux si bien que le bétail échappe aux massacres. C’est le cas de la région de Coalcomán.
- 3 Dans son Informe de 1947, le président de la République déclare : « Pour dédommager les ejidatario (...)
- 4 Il passe de 200 000 à 104 000 d’après les recensements agricoles de 1950 et 1960 (État de Guanajua (...)
- 5 Enquête auprès de Luis Gonzalez Zepeda (Cotija).
26La destruction du cheptel bovin dans le centre du pays devrait relancer la demande d’animaux de travail et encourager la production dans les régions périphériques. Il n’en est rien car la Banque agricole encourage alors l’acquisition de chevaux et de mules, ainsi que le remplacement des anciens araires par les charmes métalliques plus modernes (Perez, 1989). Ce remplacement des anciens attelages (araire et bœufs) par de nouveaux (charrue et chevaux ou mules) est déjà bien avancé dans certaines régions où la formation d’ejidos et les crédits offerts par la banque de crédit ejidal facilitent l’acquisition du nouvel attelage par de nombreux bénéficiaires de la Réforme agraire (Cochet, 1988). L’épidémie de fièvre aphteuse et les politiques incitatrices des années suivantes favorisent la généralisation de ce changement technique à de nombreuses régions3. C’est le cas du Bajío où le nombre de bœufs recensés dans l’État de Guanajuato est divisé par deux entre 1950 et 19604 : Du même coup, la demande de ces régions agricoles en taureaux ou en bœufs de travail est brutalement réduite. Les marchands de bestiaux de Cotija se procurent désormais des chevaux dans l’État de Durango pour les revendre aux agriculteurs, délaissant alors la foire de Peribán5. La dernière cotation de bétail à Peribán a lieu en 1957, mais le dynamisme de cette foire a déjà beaucoup souffert du développement des voies de communication qui permettent aux maquignons de s’approvisionner sur les lieux même de production.
27À la même époque, la mécanisation fait des progrès considérables, surtout dans les grands périmètres irrigués avec l’application des nouveaux « paquets technologiques » de la « Révolution verte ». Le nombre de tracteurs est multiplié par quatre entre 1950 et 1970 (Linck, 1988 a). La définition plus récente de politiques agricoles, visant à stimuler le développement des zones d’agriculture pluviale, permet un nouveau doublement du nombre de tracteurs utilisés au Mexique et accélère le recul de la culture attelée.
La transformation de l’élevage bovin et la nouvelle spécialisation régionale
- 6 Voir Francisco Perez Gil, 1892 : tableau 45.
28Devant l’évolution défavorable du marché des animaux de travail, les éleveurs de Coalcomán réorientent progressivement leurs productions animales. La pénurie de fourrage pendant la saison sèche limite les possibilités de production de viande car les animaux perdent alors le gain de poids enregistré pendant la saison des pluies. L’élevage s’oriente donc vers la production d’animaux plus jeunes, susceptibles d’être engraissés dans les régions humides du pays bénéficiant de meilleures conditions de productivité. Cette évolution est encouragée par les maquignons qui exigent désormais des animaux âgés de quinze à dix-huit mois. Si l’on en croit les données rassemblées dans le rapport gouvernemental de 1892, les animaux de moins de trois ans représentent 36 % des effectifs de quelques troupeaux de la région de Coalcomán6. D’après les recensements agricoles, cette proportion serait de 55 % en 1950 et de 60 % en 1970 pour la commune de Coalcomán. La composition des troupeaux évolue donc profondément, la Sierra de Coalcomán devenant une région spécialisée dans l’élevage naisseur. Elle approvisionne désormais les régions d’embouche qui disposent d’importantes ressources fourragères, le Bajio et l’État de Jalisco (sorgho), mais surtout les régions tropicales humides du golfe du Mexique et, en particulier, la région de la Huasteca aux confins des États de Tamaulipas, Veracruz et San Luis Potosi (fig. 26 et 27). En 1986-87, la Huasteca engraisse près de la moitié des jeunes taurillons mâles nés dans la commune de Coalcomán.
Figure 27. Destinations principales des ventes de taurillons de la commune de Coalcomán et régions d’embouche.

29Les animaux de réforme (vaches et bœufs) n’effectuent pas un aussi long voyage. Ils sont destinés aux abattoirs périurbains de Uruapan, Morelia et Guadalajara. Deux ou trois têtes de bétail sont aussi abattues chaque jour à Coalcomán pour approvisionner le marché local.
- 7 Enquête auprès de Renauld Arizabalo, (Tempoal, Veracruz).
30Cette spécialisation progressive ne serait pas possible sans le développement des voies de communication routières et ferroviaires, car plus de 1 000 km séparent la Sierra de Coalcomán des régions d’embouche. Depuis 1941, la prolongation de la ligne ferroviaire de Uruapan jusqu’à Apatzingán relie la grande dépression des Terres Chaudes au centre du pays. Avant que soient achevés la piste de Coalcomán et le pont sur le Rio Tepalcatepec, les premiers troupeaux de bétail maigre à destination de la Huasteca étaient acheminés à pied jusqu’à Apatzingán et convoyés en train jusqu’à Ciudad Vallès, capitale de la Huasteca7.
- 8 Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán, 1954 et 1958.
31Le bétail « créole » qui parcoure les montagnes de Coalcomán n’est pas adapté aux nouvelles exigences du marché. Dès les années quarante, les premiers envois de reproducteurs améliorés sont organisés par les régions d’embouche à l’initiative de l’ancien président de la République Lazaro Cardenas. Celui-ci aurait même facilité la reddition des rebelles cristeros de Coalcomán en leur offrant des taureaux sélectionnés. Plus tard, c’est l’Union des éleveurs de Coalcomán qui prend en charge l’amélioration génétique du troupeau, en se procurant des reproducteurs zébus (Gyr, Indobrasil et Brahman) dans les régions d’embouche8. Le bétail de type zébu, de plus grande taille que les animaux « créoles » et mieux conformé, donne de meilleures carcasses puisque tel est désormais le produit recherché par les « engraisseurs » du tropique humide. Les zébus sont aussi très bien adaptés à la topographie accidentée de la Sierra de Coalcomán, à son climat tropical à deux saisons et sont encore plus résistants que les animaux « créoles » dans la recherche de la nourriture en fin de saison sèche.
32Mais cette adaptation progressive à une plus grande production de viande se réalise au détriment de la production laitière qui diminue progressivement. On continue de prélever une partie du lait avant de laisser au veau la part qui lui est due ; mais cet équilibre entre la part de lait prélevée pour la production fermière de fromage ou la vente directe du lait et celle consacrée à la croissance du veau varie suivant les exploitations. Il dépend de leur emplacement par rapport au bourg de Coalcomán : en effet, la croissance urbaine de Coalcomán conduit un petit nombre d’éleveurs établis à proximité du bourg à privilégier la production laitière, en vue d’une commercialisation quotidienne directe. Au contraire, l’éloignement encourage le choix contraire et l’abandon pur et simple de la traite (partie 4, p. 215).
33Quand la production principale est celle de taureaux de trois ou quatre ans, l’amélioration génétique est évidemment impossible à mettre en œuvre sans une modification préalable de la conduite du troupeau et un isolement systématique des mâles. C’est donc la vente plus précoce des mâles qui permet la généralisation des croisements avec les reproducteurs zébus et la disparition lente – par absorption – du bétail créole.
- 9 Leurs noms correspondent à ceux des éleveurs « d’avant-garde » qui apparaissent dans le rapport d’ (...)
34L’adaptation du bétail de Coalcomán à sa nouvelle mission se fait lentement. Les troupeaux qui appartiennent aux rancheros les plus influents de Coalcomán sont les premiers à bénéficier des services des nouveaux taureaux9. Mais les éleveurs plus modestes ou trop éloignés du centre de la commune doivent attendre plusieurs années avant de racheter aux premiers bénéficiaires les taureaux déjà vieux ou leurs descendants croisés. Ce n’est qu’à partir de 1970 que le sang zébu domine le phénotype de tous les animaux de la commune. À partir de cette époque, les ventes de bétail jeune deviennent systématiques.
35Aux nouveaux critères du marché en matière de génétique s’ajoutent de nouvelles exigences sanitaires. Le triple vaccin contre le charbon symptomatique (roncha), la fièvre charbonneuse et la septicémie hémorragique est appliqué de plus en plus systématiquement. Après la désastreuse campagne mexico-américaine de lutte contre la fièvre aphteuse, celle contre le varron (Gusano barrenador) donne de meilleurs résultats, grâce à la mise au point d’une lutte biologique par stérilisation des mouches. Malgré l’absence de statistique fiable disponible au niveau municipal, il est certain que l’éradication de ce parasite externe permet alors une diminution de la mortalité des veaux et une accélération globale de la croissance des troupeaux. En revanche, la campagne nationale de lutte contre les tiques ne donne pas les résultats escomptés, en dépit des 50 bains anti-tiques installés dans la commune de Coalcomán.
- 10 Moyenne établie sur sept années (1981-1987) d’après les informations disponibles à l'Asociacion Ga (...)
36Enfin, l’évolution des circuits de commercialisation entraîne une modification du calendrier des ventes de bétail. Plus de 50 % des ventes ont lieu désormais vers la fin de la saison des pluies, entre les mois de septembre et novembre, et 25 % sont concentrées au mois d’octobre10. La figure 28 témoigne de cette évolution.
37À l’époque de la foire de Peribán, les taureaux étaient tous vendus pendant la semaine du dimanche des Rameaux, à la fin du mois de mars. Cette époque coincidait avec l’épuisement des résidus de récolte laissés sur le champ après la récolte du maïs. Vendre les animaux au mois d’octobre autorise donc, en principe, une importante économie de fourrage, l’entretien d’un plus grand nombre de mères et donc la spécialisation progressive du troupeau vers les activités de reproduction. Cette économie de fourrage est d’autant plus appréciable que les surfaces emblavées en maïs – et donc la quantité de résidus disponibles pour le bétail – ont beaucoup diminué. Néanmoins, c’est à la fin de la saison des pluies que les herbages sont les plus abondants à Coalcomán et il semblerait plus logique de retarder un peu la vente des animaux jusqu’à Noël pour valoriser au mieux les pâturages. Mais les éleveurs de Coalcomán ne peuvent choisir l’époque qui leur convient, car ceux des régions tropicales humides imposent aux régions « naisseuses » le calendrier leur permettant de maximiser les bénéfices. Octobre et novembre sont des mois à très forte capacité fourragère dans les régions tropicales humides du golfe du Mexique, où la saison des pluies dure beaucoup plus longtemps. Les négociants en bétail de la Huasteca commencent donc leurs activités dès le mois de septembre, bien avant que les ressources fourragères des régions « naisseuses » viennent à s’épuiser. C’est aussi à cette époque que la plupart des taurillons nés dans la Sierra de Coalcomán atteignent l’âge de dix-huit mois souhaité par les acheteurs. Beaucoup de fécondations ont lieu pendant la saison des pluies et les produits naissent au printemps.
Figure 28. Ventes mensuelles de béta hors de la commune de Coalcomán (1981-1987)

Source : voir annexe 8.
38Le regroupement des ventes à la fin de la saison des pluies est encore plus marqué pour les jeunes taurillons. Environ 70 % des ventes de mâles ont lieu entre septembre et novembre, alors que cette proportion n’est que de 35 à 40 % pour les femelles (fig. 29). Il s’agit alors de vaches de réforme (pour la plupart) vendues tout au long de l’année, sauf en saison des pluies. Les seuls taurillons achetés indifféremment toute l’année sont ceux destinés à certains ranchos d’engraissement hors-sol du Bajio, où les ressources fourragères dépendent davantage de la dernière récolte de sorgho que de la saison des pluies.
39En une vingtaine d’années, la Sierra de Coalcomán occupe une place entièrement nouvelle dans la division du travail. Toutes les anciennes activités développées dans les ranchos sont peu à peu réduites aux capacités d’absorption du petit marché constitué par le bourg de Coalcomán (encore relativement protégé par l’éloignement de la région). La production de jeunes taurillons de dix-huit mois devient la seule activité qui puisse être commercialisée au-delà des limites de la commune. Une certaine « tradition » en matière d’élevage bovin existait depuis longtemps, mais l’abaissement de l’âge de vente des animaux ne représente pas qu’un simple changement technique. La vente d’animaux jeunes et l’abandon de toutes les autres activités transforment la région en zone « naisseuse », au service des régions d’embouche.
Figure 29. Répartition par sexe des ventes de bétail hors de la commune de Coalcomán en 1987.

Source : voir annexe 8.
40On assiste en réalité à la naissance de la « vocation pastorale » de la Sierra de Coalcomán. Car cette « vocation », si souvent évoquée et rabâchée par les grands éleveurs et les agents de l’administration, ne possède aucun caractère inné. C’est une région productrice de grains (maïs et pois chiche) qui devient en quelques années productrice de « broutards ». Cette « vocation » est donc créée de toutes pièces par le renforcement de la spécialisation régionale. Dans les années cinquante et soixante, l’urbanisation croissante et le gonflement des classes moyennes, obtenus grâce au « miracle mexicain », décuplent la demande interne de viande en élargissant considérablement le marché intérieur. Alors que le développement spectaculaire de la production de porcs et de volailles permet d’approvisionner le marché intérieur, l’entrée des États-Unis sur la scène des importateurs de viande bovine maintient son prix élevé au Mexique. Tandis que d’importants troupeaux de taurillons franchissent périodiquement la frontière du nord, le marché national connaît au contraire de fortes hausses des prix et la pénurie. De fait, la consommation de viande bovine reste réservée aux classes aisées et surtout urbaines, car on mange encore peu de ce produit dans les campagnes.
41L’importance prise par l’élevage dans le développement historique du Mexique est surtout due aux immenses étendues du nord où s’est multiplié si rapidement le bétail introduit par les Espagnols. Aujourd’hui encore, les régions du nord restent caractérisées par l’élevage bovin extensif. Elles alimentent régulièrement le marché nord-américain en jeunes taurillons sur pied destinés à être engraissés dans les feed lots du Texas et de la Californie. Entre 1960 et 1980, plus de 70 % des veaux mâles nés dans le nord du Mexique franchissent ainsi la frontière (Reig, 1982). La production bovine du nord assure aussi l’approvisionnement des grandes villes du nord (Monterrey) et de la frontière.
Figure 30. Évolution comparée de l'indice général des prix et de l’indice du prix de la viande bovine (1927-1977) (indice 100 en 1927).

Source : d'après les données de Igeni-lnah (1986) (voir annexe 7).
42Mais la croissance de la production nationale bovine et l’extension des surfaces consacrées à l’élevage sont surtout le fait des régions tropicales, situées de part et d’autre de l’altiplano central et du sud-est du pays. Depuis 1950, les régions tropicales sont soumises à une intense colonisation agricole, encouragée par les pouvoirs publics dans le cadre de la « marche à la mer » dont les éleveurs sont les principaux bénéficiaires. Elles constituent désormais le pôle le plus dynamique de l’élevage bovin mexicain, en devançant les régions du nord. Plus de la moitié du bétail engraissé chaque année au Mexique provient maintenant des zones tropicales humides du pays. Aux régions déjà spécialisées depuis longtemps dans les activités d’élevage (Huasteca, côte de l’État de Chiapas), s’ajoutent toutes les régions du sud-est récemment défrichées (sud de l’État de Veracruz, États de Tabasco, Chiapas et Yucatan). La croissance globale du troupeau s’y accompagne d’une modification générale de sa composition : la proportion de vaches diminue progressivement, reflétant ainsi la spécialisation du « tropique humide » dans les activités d’engraissement (Reig, 1982). Cette proportion augmente par contre dans le nord (exportateur de bétail sur pied) et dans les régions tropicales moins arrosées de la frange pacifique (Sierra Madre del Sur dans les États de Oaxaca, Guererro, Michoacán, Colima et Jalisco) transformées en régions « naisseuses ». D’importants flux de bétail jeune se dirigent maintenant de la côte Pacifique sèche vers la côte humide du golfe du Mexique pour converger quelques mois plus tard vers le grand marché de Mexico. La région de la Huasteca importe à elle seule entre 60 000 et 80 000 animaux maigres par an (Reig, 1982 ; Hernandez, 1984) ; beaucoup d’entre eux proviennent des zones escarpées de la Sierra Madre del Sur.
- 11 Sur ce thème, voir Hubert Cochet et al., 0988) et Thierry Linck 0988 b).
43L’expansion de l’élevage bovin au Mexique ne résulte pas d’une augmentation de la productivité des troupeaux (du taux d’extraction). Ce sont deux frontières – politique au nord et agricole au sud-est – qui ont permis une extension de l’élevage, sans que les techniques extensives ne soient réellement remises en question. Néanmoins, le développement de l’élevage bovin dépasse largement ces régions pour concerner en réalité la plupart des unités d’exploitation que nous avons pu observer dans la région occidentale du Mexique. Au sein même des ejidos, l’élevage extensif devient un moyen privilégié de l’accumulation, un facteur clé de la différenciation paysanne et le passage obligé vers d’autres spécialisations11. Dans la Sierra de Coalcomán, l’élevage bovin « naisseur » devient peu à peu le centre de gravité de l’exploitation agricole, exploitation dont l’établissement remonte ici à plus d’un demi-siècle. Si les grands défrichements du sud-est mexicain constituent l’aspect le plus spectaculaire de l’expansion de l’élevage iganaderización), ils n’en représentent qu’un élément. Toutes les autres régions ont été concernées à un moment ou à un autre.
CULTURE SUR BRÛLIS ET INTENSIFICATION FOURRAGERE
44Parmi les activités propres au rancho de la Sierra de Coalcomán au début de ce siècle, seul l’élevage bovin connaît un développement important et surtout une adaptation de ses caractéristiques aux nouvelles exigences des régions d’embouche. Qu’advient-il de la culture sur brûlis qui, au même titre que l’assolement pois chiche/maïs en terres labourées, constituait un pilier de la production ? Elle n’est pas évoquée dans le paragraphe consacré à l’élimination progressive de presque toutes les cultures, car sa participation aux systèmes de production n’est pas remise en question par la nouvelle orientation économique de la région. En effet, la culture sur brûlis est à la base du développement de l’élevage, car elle produit désormais les pâturages nécessaires au bétail. De productrice de grain, la culture sur brûlis devient aussi la principale productrice d'herbe.
L’évolution de la culture sur brûlis : l’herbe au dépens de la friche
45Avec la maladie du pois chiche et l’abandon consécutif des terres labourées, la culture sur brûlis redevient le seul système de culture pratiqué dans la Sierra de Coalcomán comme au xixe siècle, avant que ne s’installent dans la région les immigrés blancs originaires des hautes terres. Mais les parcelles cultivées de la sorte, ainsi que les techniques mises en œuvre, ne ressemblent plus à celles de l’ancien système. Les parcelles abattues ne sont plus des forêts primaires ni même secondaires. Elles ressemblent davantage à un taillis arbustif âgé seulement de quelques années, dans lequel il serait difficile de trouver un tronc plus épais que le poignet d’un homme. Tous les agriculteurs utilisent désormais les engrais chimiques et les herbicides. Malgré cela, le maïs est plus « sale » que jamais car la parcelle est envahie de graminées fourragères parfois plus hautes que le maïs lui-même. Le cycle de culture est réduit à une seule année, la parcelle étant abandonnée après la première récolte. Comment en est-on arrivé là ?
46La poussée démographique a des conséquences directes sur le raccourcissement de la période de recrû forestier. En outre, l’abandon des terres labourées, leur stérilisation relative, et le recentrage des activités agricoles autour du système de culture sur brûlis ont certainement accru la pression exercée sur l’espace soumis à la rotation forestière de longue durée. On connaît les conséquences d’une éventuelle accélération de la rotation : de la longueur de la friche forestière dépendent les conditions de la culture lors d’un prochain cycle d’abattis-brûlis. Seule une période de friche suffisamment longue permet en effet, de lever les deux principaux obstacles que deux années de culture font surgir : l’invasion de la parcelle par le tapis herbacé et l’épuisement du stock d’éléments minéraux nécessaires à la culture (partie 2, p. 67). Quand la durée de la période de friche ne permet plus une reconstitution suffisante de la forêt, c’est la cohérence même du système de culture qui est atteinte. Le sous-bois n’est pas complètement débarrassé de la strate herbacée ; la biomasse abattue et brûlée commence à diminuer. Comme le feu diminue d’intensité, le « nettoyage biologique » de la parcelle est moins efficace. Les parasites se développent plus vite – vers blanc (Phyllophaga sp.), Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), etc. – et leur progression est facilitée par la plus grande proximité des différentes parcelles emblavées en maïs. Les rendements sont orientés à la baisse.
- 12 Mazoyer, notes de cours (s. d.).
47Enfin, l’univers forestier s’ouvre de plus en plus, les clairières se rapprochant les unes des autres et n’étant plus séparées que par des franges de bosquets clairsemés. L’épuisement des forêts hautes ou moyennes provoque une diminution de l’effet tampon que l’écosystème forestier exerce sur le climat. Le volant d’eau stocké dans la biomasse diminue et le ruissellement s’accélère. Quelques jours ou même quelques heures après chaque pluie, de nombreux torrents sont de nouveau à sec alors que, d’après les agriculteurs interrogés, l’écoulement était jadis permanent. Avec le ruissellement, l’érosion s’accentue également sur les versants nus. Il est même possible que le réchauffement relatif des basses couches de l’atmosphère – consécutif à la diminution de la quantité d’eau stockée dans la biomasse aérienne – ait un effet négatif sur le déclenchement des pluies12. Malgré les reliefs de la Sierra Madre del Sur, les masses d’air océaniques ne se condensent plus aussi facilement au contact du sol surchauffé. C’est peut-être ce qui explique, en partie, le retard de plus en plus fréquent des premières pluies observé par les agriculteurs.
48Aujourd’hui, la culture du maïs sur brûlis présente toutes les caractéristiques d’un système dont les conditions de réussite ne sont plus réunies. De grandes étendues sont entièrement défrichées ; l’érosion se voit en de nombreux endroits ; les rendements en grains ont de toute évidence diminué. Mais il faut revenir aux causes et conditions qui ont provoqué et permis le raccourcissement de la durée de repousse forestière de plus de vingt ans à moins de cinq années seulement.
49L’augmentation démographique a été en réalité faible, d’autant plus que le départ massif des métayers vers de nouveaux horizons a remis en question plusieurs décennies de croissance démographique. Le maximum démographique est atteint en 1960, mais la population rurale de la commune (celle qui n’est pas concentrée au bourg) cesse d’augmenter à partir des années cinquante.
50Nous avions estimé à 1 500 le nombre de familles rurales de la commune dans les années vingt ou trente. Pour disposer d’une récolte de 5 t, chaque famille devait disposer au minimum de 40 ha d’écosystème forestier pour une rotation forestière qui durait vingt ans (avec des rendements de 15 q/ha la première année de culture et de 10 q lors de la deuxième récolte). En 1950, le nombre de familles passe à 2 000 environ, mais il n’augmente plus ensuite. Même si l’on considère qu’à la suite de l’abandon des terres labourées, la totalité de ces familles cultivent désormais leur maïs sur brûlis, la pression exercée sur l’écosystème forestier soumis à ce mode de mise en valeur n’est pas en mesure de compromettre vraiment sa reproductibilité.
51Pour conserver la même durée de repousse forestière (vingt ans) et obtenir 5 t de grains, la famille devrait disposer d’une surface minimale de 100 ha, en obtenant 10 q de grains par hectare (la parcelle n’étant alors cultivée que une année). Si l’on applique cette hypothèse défavorable aux 2 000 familles qui vivent dispersées dans la commune de Coalcomán vers 1960, la surface totale nécessaire au maintien à vingt ans de la durée de la rotation forestière est de 200 000 ha. Cette surface est encore inférieure à celle de la commune (environ 280 000 ha). Elle correspond approximativement à la surface agropastorale exploitée actuellement dans la commune, le reste étant encore couvert de forêts de pins. À l’exception de ces dernières, la culture sur brûlis concerne désormais la totalité du territoire communal mais la densité démographique reste faible. Elle est de 10 hab./km2 en 1960 lorsque le maximum démographique est atteint. Elle n’est que de 6,5 hab./km2, si l’on ne tient pas compte de la population « urbaine » de Coalcomán (mais en soustrayant au calcul de la superficie les espaces couverts de forêts de pins, non concernés par la culture sur brûlis).
52La pression démographique ne permet donc pas, seule, d’expliquer les modifications apportées au système de culture sur brûlis.
53Dans les années soixante, deux changements techniques modifient profondément la culture du maïs sur brûlis : le développement des cultures fourragères et la généralisation de l’usage des herbicides.
- 13 L’Union des éleveurs de Coalcomán en recommande le semis dès 1958 (Ligue de la petite propriété ag (...)
54Dès 1960, les graminées fourragères sont donc introduites dans la rotation forestière de longue durée. Semées dès la première année de culture avec le maïs et en début de saison des pluies comme lui, elles remplacent ensuite la deuxième année de maïs et perdurent plusieurs années avant que la friche ne reprenne finalement le dessus. La gordura (Melinis minutiflord) est la première graminée fourragère introduite13. Elle pousse bien dans les zones plutôt fraîches au-dessus de 1 200 m d’altitude, mais son enracinement superficiel la rend sensible au piétinement du bétail. Elle est facilement arrachée par les animaux et ne peut supporter que quelques années de pâturage, avant d’être à nouveau recouverte par la friche. Le jaragua (Hyparrhenia rufa) est introduit une dizaine d’années plus tard dans les zones plus chaudes situées entre 700 et 1 500 m d’altitude. C’est un fourrage plus grossier, moins appétent lorsqu’il est sec que la gordura, mais plus résistant à la dent des animaux. Il est particulièrement apprécié des éleveurs car il ne s’épuise jamais, pour peu que l’on prenne soin de brûler régulièrement les refus (en fin de saison sèche) et de mettre en défens certaines parcelles jusqu’à l’épiaison. Les pratiques culturales mises en œuvre pour l’entretien des prairies dépendent, bien sûr, du type d’éleveur (partie 4, p. 215).
55Notre propos, pour l’instant, est de noter que les graminées fourragères font désormais partie du paysage de la Sierra de Coalcomán. Elles le dominent en de nombreux endroits, la forêt ayant laissé place à un paysage qui ressemble désormais à une savane arborée. Les derniers arbres sont les tepehuajes (Lysiloma acapulcensis), sauvegardés en raison de l’usage de leur bois dans la confection des poteaux de clôture, et les pins (au-dessus de 1 500 m) protégés depuis peu par l’administration forestière.
56L’introduction et la généralisation des herbicides sont contemporaines de celles des fourrages semés. Le champ de maïs est maintenant aspergé à l’Esteron, un herbicide qui détruit toutes les adventices « à feuilles larges » (dicotylédones). Tous les agriculteurs de la commune de Coalcomán l’utilisent une fois, environ un mois après les semis de maïs, à l’aide d’une pompe portative.
57L’usage d’un herbicide non spécifique a de quoi surprendre. L’introduction d’un produit spécifique (il en existe au Mexique) aurait été davantage adaptée à l’évolution des deux systèmes de culture producteurs de grains qui étaient pratiqués dans les ranchos. Sur les terres à bœufs, l’usage d’un tel produit aurait réglé en partie le problème des labours de jachère et permis le maintien de la culture du maïs (surtout après introduction des engrais chimiques). En culture sur brûlis, un herbicide spécifique du maïs permettrait de lutter contre les adventices, problème grave dès la première année de culture par suite du raccourcissement de la période de recrû.
58Si l’herbicide choisi ne détruit que les dicotylédones, c’est que les graminées fourragères associées au maïs comptent désormais autant que celui-ci. L’herbicide les protège tout autant que le maïs d’une concurrence trop forte des adventices. Avec ce nouveau moyen de production, il n’est plus indispensable d’attendre que le recrû ait entièrement éliminé les herbes du sous-bois. Les adventices « à feuilles larges » sont éliminées par le produit chimique et celles « à feuilles étroites » ne représentent plus une gêne, puisque les graminées sont devenues le principal produit recherché. La plupart des touffes d’herbe qui résistent au recrû arbustif ne sont d’ailleurs que les restes de la prairie implantée pendant le cycle de culture précédent.
59Dans un contexte de raréfaction accélérée de la main-d’œuvre (voir plus loin), l’usage de l’herbicide permet donc un accroissement significatif de la productivité du travail car il suffit maintenant d’abattre une friche de quelques années seulement et d’asperger ensuite la parcelle d’Esteron pour obtenir une prairie convenable. Cela représente un moindre travail que d’abattre et de débiter une forêt primaire.
60Cette évolution est facilitée par l’emploi des engrais chimiques qui se généralise peu de temps après, à partir de 1970. Le sulfate d’ammonium (20,5-0-0) est maintenant utilisé par tous les agriculteurs de la commune de Coalcomán, bien que son transport à dos de mule jusqu’aux hameaux les plus éloignés du bourg ait retardé quelque peu son emploi. Environ un mois après les semis, une poignée de ce sulfate est déposée manuellement au pied de chaque poquet de maïs, immédiatement après aspersion de la parcelle à l’herbicide. Cet engrais n’a jamais été utilisé sur les terres à bœufs, pas plus que les herbicides. Au contraire, son apparition semble avoir précipité l’abandon des terres labourées, comme le laissent entendre les agriculteurs qui évoquent les premières années de son utilisation : « avec ça, on pouvait faire du maïs n’importe où ; plus besoin de labourer ». Pourtant, l’azote répandu ne remplace pas les autres éléments minéraux (phosphore, potassium) accumulés dans les cendres d’un « bon » brûlis. Ce n’est sûrement pas la réponse technique la mieux adaptée aux nouvelles conditions de la culture du maïs, imposées par le raccourcissement de la période de repousse forestière. La prairie temporaire, par contre, a tout à gagner d’un épandage d’azote. Herbicides et engrais n’ont pas permis d’enrayer la baisse des rendements de maïs, car ce sont les graminées fourragères qui ont le plus profité de ces nouveaux intrants.
61Il semble donc que ce soit la généralisation d’une nouvelle association/succession (maïs-prairie temporaire) et de nouveaux moyens de production (herbicides et engrais) qui provoquent le raccourcissement de la période de recrû forestier, plus encore que la pression démographique exercée sur l’écosystème cultivé.
- -En début de cycle, le développement de la prairie pendant la première saison des pluies est déjà important. Resemer du maïs une deuxième année est impossible, car le développement herbacé atteint son paroxysme lors de la deuxième saison des pluies. Mais la repousse forestière est retardée de plusieurs années par ce nouveau pâturage, surtout s’il est régulièrement entretenu et « prolongé » au maximum (taille des rejets de souche, brûlage des refus). Ce n’est qu’à partir de la sixième ou septième année que la repousse forestière peut enfin démarrer (fig. 31).
- -En fin de période, le cycle est également raccourci : la forêt, qui constituait l’élément central du système de culture, sur lequel reposaient les conditions de sa reproductibilité, ne sert plus à rien. Elle ne produit pas d’herbe. Il faut l’abattre pour en produire (Hay que tumbarpara que baya pastura). L’herbe, qui était l’ennemi numéro un de la culture, devient son objectif principal. Au lieu de la combattre, tout est fait pour favoriser son développement. La friche est de nouveau abattue et brûlée alors qu’elle n’est âgée que de quelques années.
62La période de recrû est réduite par les deux extrémités. La friche commence plus tardivement et on l’interrompt dès que possible pour accroître la surface en herbe. C’est donc l’essor des prairies temporaires qui limite l’espace consacré à la production de maïs sur brûlis. En provoquant une accélération de la rotation forestière, il brise la cohérence du système de culture sur brûlis sans que les herbicides et les engrais ne viennent ralentir durablement la dégradation consécutive des conditions de culture du maïs. La production de maïs sur brûlis traverse donc une crise grave qui s’ajoute à celle qu’avait connu la culture de pois chiche et de maïs sur les terres labourées.
Figure 31. Représentation schématique de l'évolution de la culture sur brûlis dans la commune de Coalcomán.

Peut-on parler d’intensification fourragère ?
63Avec le développement des prairies temporaires, l’orientation fourragère des systèmes de production est de plus en plus évidente. Mais comment mesurer cette nouvelle production fourragère ? Comment estimer l’augmentation de charge de bétail à l’hectare qu’elle autorise ?
- 14 Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán (1958), Gobiemo municipal de Coalcomán (1984, 1 (...)
64Malgré le manque de fiabilité des données concernant les effectifs bovins des différents recensements agricoles, la croissance du troupeau semble confirmée pour la commune de Coalcomán. Le recensement de 1950 avance le chiffre de 30 500 têtes de bétail. L’ordre de grandeur est confirmé par les estimations de l’Union des éleveurs de Coalcomán qui donne 36 000 têtes en 1958. En 1984-85, le maire signale l’existence de 80 000 bovins dans son rapport annuel. En 1987, 33 900 bovins sont déclarés par les éleveurs de Coalcomán, mais le président de leur Union remarque que la coutume « autorise » les éleveurs à ne faire enregistrer que 60 % de leur troupeau14. Les effectifs réels seraient alors de 56 500 têtes. Il est raisonnable de penser que le véritable chiffre est compris entre ces deux dernières estimations : 60 000 ou 70 000 bovins, ce qui représente un doublement des effectifs en trente ans. La charge animale moyenne serait alors de 0,30 à 0,35 animaux par hectare (tous animaux confondus et en soustrayant de la superficie de la commune les forêts de pins non pâturées).
65Pour estimer la capacité fourragère du nouveau système, ce n’est pas la production totale de fourrage qu’il faut calculer car les unités fourragères produites au mois d’août n’ont guère d’importance. La production fourragère de la saison des pluies était déjà excédentaire avec l’ancienne forme de mise en valeur du milieu. En l’absence de pratiques de transport et de stockage des fourrages, c’est la quantité et la qualité des fourrages disponibles pendant la saison sèche qui déterminent le niveau possible des effectifs du troupeau.
66Pour estimer grossièrement la production fourragère potentielle de la nouvelle rotation et la comparer avec celle de l’ancienne rotation (fig. 31, on prendra pour base de calculs les données suivantes :
- une prairie de jaragua laissée en défens pour la saison sèche a une production potentielle de 4 t/ha de matière sèche (MS) ;
- en tenant compte des pertes par piétinement, des refus d’éléments inappétés et de la nécessité de maintenir un minimum de couverture herbacée pour éviter l’érosion, on estimera que 50 % de cette production peuvent être effectivement consommés15 ;
- nous admettrons également que 1 kg de MS fournit environ 0,5 unité fourragère (UF)16. On peut alors estimer la production fourragère consommable de 1 ha de jaragua à 1 000 UF ;
- cette estimation peut être acceptée pour les deux premières années de la prairie temporaire, mais décroît rapidement par la suite ;
- la production fourragère des résidus de culture du maïs peut être estimée à 1,5 t la première année (pour 15 q de grains produits) et à 11 pendant la deuxième année de culture de la rotation traditionnelle et la première année de l’association mais/jaragua (pour 10 q de grains produits). Les animaux peuvent alors ingérer 400 UF la première année et 250 UF environ la deuxième année.
67La production fourragère consommable des deux rotations présentées sur la figure 31 peut alors être calculée (tabl. x).
68Le cycle de la nouvelle rotation se poursuit au-delà de la vingtième année ; il existe donc un certain décalage entre les deux rotations, ce qui rend délicate une comparaison précise. En outre, l’écart enregistré entre les deux rotations est gonflé par la sous-estimation évidente de la production fourragère du recrû forestier qui n’est sûrement pas nulle. Malgré ces imprécisions, la capacité fourragère de la nouvelle rotation maïs/prairie temporaire/friche apparaît très supérieure à celle de l’ancienne rotation qui faisait occuper par la friche et la forêt les neuf dixièmes du cycle. Le développement des prairies au détriment de la forêt et des friches – la « savanisation » progressive de l’écosystème – représente donc une augmentation importante de la capacité fourragère globale du système.
Tableau X. Estimation de la production fourragère consommable de la culture sur brûlis dans l’ancienne et la nouvelle rotation (UF/ha)

(Lorsqu’une telle rotation est adoptée depuis plusieurs années, l’agriculteur dispose chaque année de n ha de prairie âgée de 1 an + n ha de prairie âgée de 2 ans + n ha de prairie âgée de 3 ans, etc.).
- 17 On admet qu’une vache et son veau consomment environ 5 UF/j, soit 10 kg MS.
69Avec 1 000 UF consommables, 1 ha de prairie peut nourrir une vache et son veau pendant plus de six mois de saison sèche. Les résidus de culture de 1 ha de maïs ne fourniraient que 400 UF effectivement consommées (pour un rendement de 15 q), soit l’énergie nécessaire à l’entretien d’une vache et de sa suite pendant 80 jours seulement17.
70Si la production totale de fourrage est considérablement augmentée par l’introduction des prairies temporaires, la qualité de ce fourrage en fin de saison sèche se dégrade. Avec l’ancien système, le bétail disposait de trois catégories de fourrages de saison sèche : les feuilles et cannes de maïs (janvier à mars), la paille de pois chiche (avril et mai) et les ressources de la forêt, peu abondantes en zone tempérée, mais très importantes dans les ravins situés à basse altitude, couverts d’une forêt tropicale semi-pérenne et parfois riche en arbres fourragers. Le nouveau système offre une quantité plus limitée de résidus de culture, l’abandon des terres labourées privant le troupeau d’une partie des résidus de maïs et de la totalité de la paille de pois chiche.
71Le problème fourrager reste donc entier à la fin de la saison sèche, car les prairies temporaires sont desséchées et refusées par le bétail. L’azote apporté à la ration par la paille de pois chiche et les arbres fourragers n’est pas remplacé. Un complément doit être distribué aux animaux les plus faibles et aux vaches allaitantes.
72Les premiers jours de la saison des pluies sont tout autant préoccupants, car la prairie peut tarder à reverdir (surtout si la première pluie significative est suivie de plusieurs jours sans eau), alors que les arbustes et les arbres de la friche ont déjà bourgeonné. C’est pourquoi les derniers lambeaux de forêt tropicale sont soigneusement conservés par leurs propriétaires qui les réservent aux animaux pendant les dernières semaines de la saison sèche (arbres fourragers). Les récents essais entrepris par certains éleveurs pour resemer du pois fourrager tentent également de compenser ce déficit non comblé par les prairies temporaires.
- 18 Voir les travaux récents de François Léger (comm. pers.) dans l’État de Colima, Mexique.
73Finalement, l’efficacité fourragère du nouveau système dépend essentiellement des pratiques adoptées en matière d’entretien et de gestion des pâturages. Après une première période de pâturage en saison des pluies, il faut retirer le bétail de la parcelle pour que les dernières pluies de la saison favorisent une bonne repousse, maintenue en défens jusqu’au milieu de la saison sèche. Quand les résidus de récolte du maïs et de la prairie associée sont consommés par le bétail, celui-ci est reconduit vers la prairie laissée en défens : une deuxième période de pâturage s'ouvre alors. Il faut cependant retirer le bétail avant que l’herbe, déjà sèche, ne soit coupée trop à ras : elle brûlerait mal lorsque le feu sera mis à la parcelle à la fin du mois de mai. Couper et brûler les rejets de souche et les arbustes qui auraient repoussé est aussi indispensable à une prompte reprise de la végétation herbacée après les premières pluies. À partir de la quatrième ou cinquième année, une prairie dégradée et non entretenue produit sans doute moins de fourrage qu’une repousse forestière dans laquelle les arbres fourragers auraient été préservés du feu18.
74Pour faciliter une telle gestion, la division de chaque propriété en plusieurs parcelles clôturées est indispensable. Dans l’ancien système, seules les parcelles labourées étaient clôturées en permanence. Les parcelles semées sur brûlis l’étaient également, mais seulement pendant les deux années de culture du maïs. Une fois les ranchos de la commune entièrement clôturés et séparés les uns des autres (1950), les propriétaires ont commencé à diviser leur domaine en plusieurs « quartiers ». Dans l’ancien système, la clôture, souvent en bois, protégeait la culture contre la dent des animaux. La nouvelle clôture, le plus souvent en fil de fer barbelé, a une fonction entièrement neuve : elle devient un outil fixe de gestion des pâturages. La division de la propriété en plusieurs enclos impose alors à la culture sur brûlis une autre dynamique. Le choix de la parcelle à abattre dépend de moins en moins de ses aptitudes à donner un « beau » maïs (âge de la forêt). Il est fait pour augmenter la capacité fourragère d’une parcelle déficiente ou faciliter l’organisation des déplacements du bétail.
75Une véritable intensification fourragère ne peut donc avoir lieu sans un développement simultané des techniques d’entretien et de gestion des pâturages. La quantité de fourrage produit s’est accrue, mais sa qualité à la fin de la saison sèche n’est pas améliorée. La charge en bétail ne peut donc se développer sans que soit distribué, en fin de saison sèche, un complément énergétique et azoté. Pour les petites exploitations, l’achat de fourrage (sorgho, luzerne) n’est pas envisageable (partie 4, p. 215). C’est le maïs récolté sur la parcelle qui fournit ce complément quand la récolte de grains dépasse les besoins de la famille. La production énergétique totale d’une parcelle de maïs (grains + résidus), disponible en pleine saison sèche (janvier-mars), est toujours supérieure à celle d’une prairie temporaire. 15 q de grains et autant de résidus de culture récoltés puis distribués aux animaux représentent environ 2 500 UF. C’est la quantité nécessaire à l’entretien d'une vache et de son veau pendant plus de un an (environ 500 jours), alors qu’une prairie de jaragua assure son alimentation pour seulement six mois (voir précédemment).
76Dans les ranchos de la Sierra de Coalcomán, la culture attelée était aussi une composante importante du système de production. Il faudrait donc tenir compte de sa disparition et du départ d’un grand nombre de métayers pour évaluer la production fourragère totale du rancho actuel. Dans toutes les propriétés où l’élevage extensif a remplacé la production de grains, ce n’est pas tant la capacité fourragère totale du rancho qui a augmenté, mais bien davantage la production d’unités fourragères par travailleur. Là où 4 ou 5 métayers produisaient chacun 2 000 ou 3 000 UF/an sous forme de résidus de culture, un seul travailleur en produit maintenant 10 000 ou 15 000. Dans de nombreux ranchos, l’intensification fourragère, théoriquement permise par l’implantation de prairies temporaires, n’a pas vraiment eu lieu, faute de techniques appropriées de gestion et d’entretien des pâturages. Mais l’implantation des prairies temporaires associées au maïs sur brûlis représente la meilleure façon de s’adapter à un contexte de raréfaction accélérée de la main-d’œuvre, en permettant une forte augmentation de la productivité du travail.
Le sens véritable de l’association maïs prairie temporaire
77Sur son propre terrain, le maïs souffre donc de la concurrence imposée par la culture associée des graminées fourragères. Cette concurrence saute aux yeux lorsque les pluies ne sont pas assez abondantes : le maïs jaunit plus vite que le jaragua qui lui est associé. S’il pleut trop, les pieds de maïs pourrissent rapidement lorsqu’ils sont « immergés » dans la prairie. Malgré l’application localisée de l’engrais au pied de chaque poquet de maïs, les graminées en profitent autant que le maïs car leurs semences se rassemblent souvent, après la première pluie, dans les replats et les creux de la parcelle, entre les pierres, où le maïs est semé de préférence. Enfin, rappelons que l’herbicide utilisé (l’Esteron) n’a aucune action sur les monocotylédones et ne protège donc pas le maïs des graminées fourragères.
78Pour évaluer l’influence réelle de l’association de culture sur le rendement de maïs grain, l’opinion des différents agents économiques concernés par l’association maïs-graminées fourragères est particulièrement significative. Leur conscience des dommages causés par les graminées au maïs dépend en fait de leur condition sociale : elle révèle les objectifs de leur système de production.
79Les grands éleveurs affirment volontiers que l’association n’affecte en rien le rendement du maïs : « ça donne pareil » disent-ils fréquemment. Mais seul le rendement global de fourrage les intéresse et non le rendement en grains d’un maïs souvent abandonné en totalité au métayer (voir plus loin). Pour ce dernier, au contraire, l’herbe est toujours le principal ennemi du maïs, tant que son droit de pâture reste limité à une ou deux têtes de bétail. Le propriétaire l’oblige à semer la prairie au milieu de son maïs mais ne lui concède pas pour autant un droit de pâturage élargi. Le métayer essaie de limiter les dégâts en dégageant un peu le pied de chaque plant de maïs. Il nettoie à la machette et à la sauvette car le propriétaire s’y opposerait. Il diffère aussi autant que possible le semis de la graminée fourragère pour permettre à son maïs de prendre un peu d’avance. La récolte devient également beaucoup plus pénible, car il faut souvent se frayer un chemin dans les hautes herbes pour accéder aux épis. Pour le métayer, l’association de culture représente donc un surcroît de travail et une baisse de rendement.
- 19 Anagsa (Aseguradora nacional agricola y ganadera).
80Lorsque les semis de graminées associées se sont développés, la compagnie nationale d’assurance agricole (Anagsa)19 a refusé d’assurer de telles parcelles, consciente de la concurrence qu’allait imposer la prairie temporaire à la culture du maïs. Les éleveurs et les techniciens agricoles n’ont pas tardé à convaincre l’Anagsa qu’il n’en était rien et que l’abondance d’herbe dans la parcelle ne résultait pas d’un manque de désherbage ! À partir de 1987, les pouvoirs publics financent même le semis des prairies temporaires sans exiger que du maïs y soit associé (partie 4, p. 215).
81Le métayer subit donc seul la baisse de productivité de son travail sur le maïs, car la nature même du contrat de métayage ne lui permet pas de se spécialiser, comme le propriétaire, dans les activités d’élevage. Le propriétaire, lui, n’est pas affecté autant par la baisse des rendements de maïs, puisque c’est le pâturage qui l’intéresse désormais.
82L’association maïs-graminées fourragères n’est pas une technique d’intensification. Sa mise en œuvre n’a pas pour but d’optimiser l’occupation de l’espace, l’exploitation des différentes couches du sol ou l’utilisation de la main-d’œuvre familiale. Ici, la culture associée est la manifestation visible d’un affrontement entre deux logiques productives différentes, opposées l’une à l’autre et qui correspondent à deux formes de mise en valeur du milieu apparemment antagonistes : la production de grains en culture sur brûlis d’une part, l’augmentation des surfaces herbagères d’autre part. L’utilisation exclusive d’un herbicide anti-dicotylédones – donc incapable de venir à bout d’une prairie de graminées – reflète parfaitement le rapport de forces entre éleveurs et métayers. La culture associée est donc l’expression d’un rapport de classe. Son analyse et son interprétation ne peuvent être menées à bien sans dépasser le niveau d’analyse du système de culture. Elle est l’objet d’un véritable marchandage entre propriétaires terriens et travailleurs, négocié dans le cadre du contrat de métayage.
L’évolution du contrat de métayage
83Dans les ranchos du début du siècle, le propriétaire fournissait la terre tandis que le métayer apportait son travail. Pour la culture sur brûlis, l’outillage – très simple – était prêté par le « patron » (partie 2, p. 67). Quand de nouveaux moyens de production font irruption dans le système de culture (herbicides, engrais), le contrat de métayage doit être modifié. Qui va payer ces nouveaux intrants, le propriétaire ou le métayer ?
84Comme on suppose que l’herbicide Esteron remplace le travail de désherbage à la charge du métayer, c’est ce dernier qui doit l’acheter. Si celui-ci ne veut pas nettoyer la parcelle à la main, il doit assurer les dépenses monétaires correspondantes à l’acquisition du nouveau produit. En général, le propriétaire prête la pompe portative dont le métayer a besoin pour traiter la parcelle. L’engrais, au contraire, ne vient remplacer aucun travail spécifique du métayer et compense plutôt la baisse de fertilité potentielle du milieu. Chacun en paie la moitié.
85Il paraît donc naturel aux deux parties que chacun assume les nouvelles dépenses correspondant à ses attributions respectives. Mais la raréfaction de la main-d’œuvre disponible (émigration) et le développement de l’association maïs-prairie temporaire viennent perturber ce nouvel accord entre métayer et propriétaire. Qui va se charger de l’implantation de la prairie temporaire ? Et comment faire accepter au métayer la charge de l’herbicide si le « nettoyage » de la parcelle qu’il permet s’adapte beaucoup mieux à la prairie associée qu’au maïs ?
- 20 Une évolution assez semblable des contrats de métayage est décrite par Esteban Barragan (1990) pou (...)
86Beaucoup de métayers réussissent à obtenir que le propriétaire prenne à sa charge une proportion plus importante des frais de culture : la totalité de l’engrais, la moitié ou la totalité de l’herbicide, et parfois même la moitié du coût de l’abattage de la parcelle. En contrepartie, le métayer doit désormais semer à la volée les semences d’herbe que le propriétaire lui donne et s’abstenir d’en entraver le bon développement. La spécialisation de la région vers l’élevage et le désintérêt croissant des propriétaires pour la culture du maïs entraînent même une remise en question de la répartition de la récolte de grains (par moitié). Certains éleveurs abandonnent la totalité du grain au métayer, ne s’intéressant qu’aux résidus de culture et à la prairie semée par le métayer. Ils ne perdent pas grand-chose, car les rendements en grains sont faibles et le maïs est difficilement valorisé sur le marché. Seul le fourrage les préoccupe. Dans ce cas, le métayer assure en général la totalité des frais de culture, à l’exception des semences de graminées toujours fournies par le propriétaire20. Il reste soumis à la volonté du patron en ce qui concerne la construction et l’entretien des clôtures (l’achat du fil de fer barbelé restant à la charge du propriétaire), ainsi que les « menus services » exigés par ce dernier. Quelques sacs de maïs offerts gracieusement par le métayer au lendemain de la récolte ne sont jamais de refus... Beaucoup de propriétaires bénéficient maintenant de prêts de campagnes accordés par le crédit agricole et d’une assurance en cas de mauvaise récolte. Mais il est rare qu’ils en fassent bénéficier leurs métayers. Le contrat de métayage ne signifie donc plus un partage du risque entre propriétaire et métayer. Ce dernier assure souvent seul les risques de la culture.
87Il s’agit d’une évolution très particulière du contrat de métayage. La récolte est donnée au métayer en échange de la prairie que celui-ci implante. En ce sens, il est encore correct de parler de « métayage », même si la récolte de grains n’est plus partagée. C’est la production totale du travailleur – maïs et prairie – qui est désormais partagée avec le propriétaire (partie 4, p. 215). Apparemment, on pourrait croire que les métayers obtiennent ainsi une amélioration substantielle de la rémunération de leur travail. À mesure que se raréfie la main d’œuvre, les propriétaires doivent concéder une plus grande partie de la récolte de grains au métayer et assurer une proportion croissante des coûts pour éviter que leurs métayers abandonnent le domaine. En revanche, aucune concession n’est faite en matière d’élevage et le droit de pâturage du métayer reste limité. Devenant la seule activité rémunératrice de la région, l’élevage est plus que jamais réservé à ceux qui possèdent la terre.
88Dans certains ranchos où le propriétaire est absentéiste, le nouveau contrat de métayage connaît une évolution encore plus poussée. Le métayer devient l’homme de confiance du propriétaire et le gérant du domaine. Il peut semer autant de maïs qu’il le souhaite (en y associant des graminées fourragères) et la récolte lui appartient en totalité. Son droit de pâture est supérieur et peut atteindre jusqu’à trente têtes de bétail. En contrepartie, il doit entretenir la propriété, réparer les clôtures, s’occuper du bétail du propriétaire et assurer la traite pendant la saison des pluies. Le lait (ou le fromage qu’il confectionne) est réparti en deux parts égales entre propriétaire et « métayer ». Si l’on excepte la production de lait partagée, la relation qui lie les deux parties n’est plus à proprement parler un « métayage ». Il s’agit plutôt d’une forme de « colonat », de plus en plus courante lorsque le propriétaire n’habite plus sur le domaine.
89À l'exception de ce dernier cas, le métayer devient donc un semeur d’herbe au service du propriétaire-éleveur. Pour l’établissement des prairies temporaires, le système de culture sur brûlis reste de loin le plus économique et celui qui autorise la plus forte productivité du travail. Dans une stratégie de développement de l’élevage extensif, entretenir les pâturages coûterait cher en main-d’œuvre : fauche des refus, fertilisation, rotation rapide du troupeau sur un grand nombre de parcelles. Il est beaucoup plus rentable d’abandonner le pâturage à la friche pour y implanter une nouvelle prairie quelques années plus tard. Car l’installation de la prairie, contrairement à son entretien, ne coûte pratiquement rien (seulement le prix de la semence). Les unités fourragères ainsi produites sont gratuites. La parcelle en friche est « prêtée » au travailleur, le temps d’y lever une récolte de maïs. Elle est rendue à son propriétaire, nettoyée et recouverte d’une prairie prête à être pâturée.
90Au début du siècle, le sur-travail des métayers était prélevé sous forme de maïs et transformé en saindoux par le propriétaire. Aujourd’hui, le mécanisme d’extorsion a changé. C’est l’implantation de la prairie temporaire par le métayer qui permet maintenant le prélèvement de la rente foncière. L’ancienne rente en nature est maintenant fournie sous forme de travail gratuit. Mais la rente prélevée sur le métayer ne constitue qu’une partie de la rente totale perçue par le propriétaire. Le nombre de métayers a en effet diminué à la suite de la crise de la culture attelée et du rétrécissement progressif de l’espace consacré à la culture du maïs sur brûlis. Le contrôle exercé par les éleveurs sur la propriété foncière génère une sorte de rente de monopole. Pour parfaire ce monopole, ils augmentent sans cesse la superficie de leurs ranchos et les effectifs de leurs troupeaux. C’est aussi ce monopole qui, en privant le travailleur de son outil de travail, rend l’implantation des prairies gratuite pour le propriétaire. Pendant les premières décennies du siècle, l’importance d’un rancho se mesurait au nombre de métayers employés. Aujourd’hui, il s’estime plutôt par le bétail qu’il possède.
LA RECONVERSION DES MÉTAYERS
91L’histoire de la commune de Coalcomán se résume à celle d’un glissement démographique, la Sierra du même nom jouant d’abord le rôle d’une zone d’accueil pour les paysans venus du centre du pays. Après 1960, la Sierra de Coalcomán devient elle-même une zone pourvoyeuse de migrants, une zone de départ. Elle expulse alors les familles qu’elle avait attirées au début du siècle. L’ensemble des transformations agraires survenues dans la région depuis 1950 s’accompagne d’une forte crise démographique. Dès 1950, la population dispersée dans les hameaux de la commune n’augmente plus. Les ranchos n’absorbent plus la croissance démographique ; c’est le bourg de Coalcomán qui en bénéficie. Sa population double (+111 %) entre 1950 et 1960. Elle représente alors plus de 35 % de la population totale de la commune. Après 1960, la population de la commune diminue d’un tiers en une dizaine d’années, alors que le taux de croissance démographique est de 3,4 %/an pour l’ensemble du Mexique entre 1960 et 1970. Après 1970, la croissance démographique de la commune reprend lentement mais le niveau atteint en 1960 n’est pas encore retrouvé en 1980. La population des hameaux et celle du bourg participent toutes deux à ce rétablissement, la proportion des personnes qui habitent au bourg restant à peu près stable (35 %) (fig. 32).
92Les premiers touchés par l’exode sont bien sûr les métayers. La maladie du pois chiche et l’abandon des terres labourées provoquent une première série de départs. Pour beaucoup de propriétaires, « les métayers sont partis quand le pois chiche est tombé malade ». La spécialisation de la région dans l’élevage naisseur extensif accentue cette tendance, car elle nécessite peu de monde et réduit continuellement la surface disponible pour les semis de maïs sur brûlis.
93La plupart des hameaux de la commune ne comptent guère plus de un ou deux métayers par propriété. Très souvent, il n’en reste aucun et le propriétaire se retrouve seul sur ses terres, à moins qu’il n’ait confié l’administration de son domaine à un parent ou à un ancien métayer. Il suffit de parcourir les pistes tracées sur le territoire de la commune pour remarquer, çà et là, les maisons abandonnées ou en ruine. Certains hameaux ont même complètement disparu comme la Barranca del Zacasihuite qui comptait plus de 30 maisons en 1940 (tabl. xi).
Tableau XI. Évolution de la population dans quelques hameaux de la commune de Coalcomán 1921-1985

Sources : recensements de population. Pour 1985, les données sont issues des recensements scolaires réalisés par les instituteurs (annexe 1, p. 310).
94La lutte menée par les métayers pour une meilleure répartition de la terre se solde par un échec et les emplois proposés dans la commune (forêt, mines) ne peuvent absorber la masse des anciens métayers. Une fois de plus, l’émigration offre des perspectives plus attrayantes : une rémunération du travail bien supérieure dans les fermes nord-américaines, un espoir d’enrichissement rapide dans les périmètres irrigués de l’État de Colima ou sur les derniers indivis des communautés indiennes de la côte.
95Les métayers et fils de métayers ne sont pas les seuls à s’en aller. Beaucoup de petits tenanciers dont la propriété s’est amenuisée, à la suite des divisions successives opérées par héritage, trouvent d’autres opportunités de travail et vendent leur lopin de terre. Parmi les moyens et grands propriétaires, nombreux sont ceux qui voient partir leurs enfants, à la suite des métayers.
L’échec de la lutte pour la terre
96Excepté la lutte pour le partage du foncier, la revendication première des métayers a toujours été l’augmentation du droit de pâture sur les terres du propriétaire. Mais rien n’a été gagné dans ce domaine, bien que l’implantation des prairies temporaires soit désormais la principale activité des métayers. Les seuls à obtenir satisfaction sont les « gérants » qui reçoivent la surveillance et l’administration d’un rancho. Eux peuvent augmenter les effectifs de leurs troupeaux sans crainte d’être expulsés. Désormais « associé » au propriétaire, le « gérant » défend le domaine comme s’il était sien et ne revendique plus ni droit de pâture ni réforme agraire. Il devient l’homme de main du propriétaire. Mais cette situation privilégiée ne concerne qu’un petit nombre de personnes. Plusieurs groupes de paysans sans terre se battent pendant des décennies pour faire appliquer la Réforme agraire dans la commune de Coalcomán, mais en vain.
- 21 Archives de la SRA, Uruapan (annexe 6, p. 342). La situation est semblable dans la commune de Vill (...)
97Dans les années trente et quarante, certains groupes de paysans obtiennent satisfaction dans la région nord-ouest de la commune, en bénéficiant de la répartition d’une partie des terres qui appartiennent à l’ex-hacienda de Trojes (fig. 23, p. 130). Après 1950, de tels succès se font de plus en plus rares. Deux ejidos forestiers sont créés en 1959. L’ejido de Pantla obtient une « rallonge » de terres (ampliación) en 1972 et l'ejido El Cuarton est approuvé officiellement en 1974. Tous les autres groupes sont déboutés par les autorités compétentes. Près de vingt ans après sa constitution légale, le groupe de Coalcomán qui réclamait l’affectation des terres de la vallée de Coalcomán voit sa demande refusée (1957). Le groupe se reconstitue sur de nouvelles bases, change de nom et fait une nouvelle demande officielle qui n’aboutit pas davantage. En 1973, et pour la troisième fois, le groupe se reconstitue, change encore de nom et recommence les démarches administratives pour demander le partage des mêmes terrains, sans jamais obtenir satisfaction. De la même façon sont rejetées les demandes faites par les groupes de Barranca del Molino (1968), Marvata et La Pajara (1971), La Zanja (1974), La Cofradia et Los Chapiles (1979), El Salitre, Las Tabernas, Corral de Piedra et Monte Verde (1980)21.
98De leur côté, les propriétaires défendent aussi leurs droits mais avec infiniment plus de succès. Depuis le début de la Réforme agraire, la loi protégeait de toute redistribution foncière la « petite propriété agricole inaliénable ». Le code agraire de 1934 et les modifications apportées sous la présidence de Miguel Aleman (1947) en fixaient les limites à 100 ha de terrain irrigué, 200 ha de terrain non irrigué ou les parcours et pâturages nécessaires à l’entretien de 500 têtes de bétail. Les « petites propriétés » ainsi protégées pouvaient donc atteindre une taille « raisonnable » et couvrir plusieurs milliers d’hectares, pourvu que la charge en bétail reste faible. La pauvreté fourragère des parcours disponibles ou la sous-utilisation qui en était faite permettaient d’éviter de franchir le plafond des 500 têtes de bétail.
99Ce plafond accordé à la propriété privée était même valable pour chacun des deux époux mariés sous le régime de la séparation des biens, ce qui facilitait encore la concentration des terres aux mains d’une même famille (Gutelman, 1974). En outre, en rétablissant le « jugement de protection » (juicio de amparo), on faisait de toute dotation agraire une véritable procédure et on donnait aux propriétaires les moyens légaux de faire traîner l’affaire dix ou vingt ans.
- 22 Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán, 1954.
100Pour mieux faire entendre leur voix, les propriétaires de Coalcomán se regroupent en 1954 et forment la Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán. Elle compte 369 membres en 1954 et 536 un an après22.
- 23 Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán, 1958.
101En 1958, les membres de la Ligue manifestent le désir de voir classer la région de Coalcomán comme « zone d’élevage » et non plus comme « zone agricole »23. La « petite propriété d’élevage » bénéficie, en effet, d’une protection légale particulière.
- 24 Ce type de discours est représenté par le travail de Pedro Saucedo Montemayor (1984).
102L’élevage (extensif) étant souvent considéré comme une caractéristique des grands domaines d’avant la Révolution, la Réforme agraire pouvait être interprétée comme une opération qui favorisait la culture, au détriment des activités d’élevage. Les éleveurs et « petits propriétaires » (entendons les moyens et grands propriétaires d’après la Révolution) s’en plaignent toujours et dénoncent la discrimination dont ils s’estiment victimes24. En réalité, la propriété d’élevage jouit d’une protection légale remarquable depuis l’époque de Lazaro Cardenas (1934-1940), pourtant considéré comme le plus progressiste des présidents du Mexique. Pour rendre compatibles la poursuite de la Réforme agraire et le développement de l’élevage, le décret de 1937 crée le principe d’« inaffectabilité pour cause d’élevage » (inafectabilidad ganadera). Cette nouvelle loi protège les grands domaines d’élevage de plus de 500 têtes de bétail pour une période de vingt-cinq ans (c’est une concession accordée par l’État), à condition que les nécessités foncières des habitants de la zone soient satisfaites. En outre, la loi précise qu’un « ejido d’élevage » ne peut se constituer que si les bénéficiaires potentiels possèdent déjà 50 % au minimum du bétail nécessaire à la superficie répartie (à moins que l’État n’avance l’argent nécessaire à cette acquisition) (Rutsch, 1984).
- 25 Cet aspect de la loi est modifié dans la nouvelle loi fédérale de Réforme agraire de 1971.
- 26 La peur d’une éventuelle affectation est toujours la raison invoquée par les éleveurs pour justifi (...)
103Au lieu d’encourager un accroissement de la charge à l’hectare et une relative intensification de l’élevage, cette protection légale incite plutôt les grands propriétaires à accroître encore leur surface. On considère alors que les zones moins peuplées du pays, en particulier les régions tropicales situées près des côtes, sont en quelque sorte réservées à l’élevage pour le développement futur du pays. Cela revient à admettre que le développement de l'élevage ne peut être qu’extensif et séparé des activités de culture. Un éleveur qui bénéficie d’un « certificat d’inaffectabilité pour cause d’élevage » ne peut alors cultiver ses terres (pas même y semer des fourrages) sous peine de voir sa propriété déclassée « terre agricole » et donc susceptible d’être affectée par la Réforme agraire25 ! Au lieu de rompre avec la vieille dichotomie, héritée de l’histoire – grand domaine d’élevage/minifundium de culture-, la législation agraire cristallise cette situation en empêchant l’association agriculture-élevage. Reflet du rapport de force entre grands propriétaires-éleveurs et paysannat pauvre, elle renforce cette séparation en opposant les cultivateurs (bénéficiaires potentiels de la Réforme agraire) aux éleveurs (victimes potentielles de la Réforme agraire)26. Ainsi, la tendance historique née de la Conquête, qui voyait les parcelles indiennes détruites par le bétail introduit par les Espagnols, est maintenue. Éleveurs et agriculteurs s’affrontent toujours dans de nombreuses régions. Ils dépendent d’administrations différentes depuis la création, en 1946, du secrétariat d'État de l’Élevage (Subsecretaria de Ganaderià). Éleveurs et agriculteurs se rassemblent aussi dans des organisations différentes ; des Associations d’éleveurs se créent dans tout le pays, regroupées en Unions régionales d’éleveurs et fédérées dans la toute-puissante Confederación Nacional Ganadera qui devient l’interlocuteur exclusif de l’État en matière d’élevage et un instrument de lutte contre la Réforme agraire. À Coalcomán, l’Association des éleveurs se crée en 1953 et regroupe les mêmes personnes que la Ligue des « petits » propriétaires. La place des éleveurs dans la classe politique (la « famille révolutionnaire ») est de plus en plus importante et leur pouvoir augmente sans cesse. Il ne sera jamais sérieusement remis en question.
- 27 L’indice de agostadero mesure le nombre d’hectares nécessaires à l’entretien d’une tête de bétail. (...)
104Le plafond établi par la législation pour définir la taille des « petites propriétés d’élevage inaliénables » a toujours été fixé en nombre de têtes de bétail, sans qu’aucune précision ne soit apportée concernant la capacité fourragère des terrains. Quand, à partir de 1965-66, l’État refuse de renouveler les concessions d’élevage accordées vingt-cinq ans auparavant (la pression sociale exercée par des millions de paysans sans terre ne l'autorise pas), le calcul précis de la charge permise par chaque type de pâturage devient indispensable. Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale de Réforme agraire (1971), les « coefficients de pâturage » (indice de agostadero), ou nombre d’hectares nécessaires à l’entretien d’une unité de bétail, sont désormais calculés par les fonctionnaires du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage27.
105Ces cœfficients, publiés au Journal officiel, servent alors de base légale pour le calcul de l’extension maximale des « petites propriétés inaliénables » (Rutsch, 1984). Ils constituent un instrument politique de protection de la propriété privée, plutôt qu’un outil de gestion rationnelle des pâturages. Ainsi, les « cœfficients de pâturage » proposés pour la région de Coalcomán (annexe 10, p. 350) varient de 6 à 12 ha par animal adulte pour les forêts de pins et de chênes (1 200-1 400 m d’altitude) et l’étage intermédiaire de feuillus (800-1 200 m). Les charges moyennes que nous avons pu calculer pour les exploitations d’élevage extensif de la commune de Coalcomán sont largement supérieures : il suffit en général de 4 à 5 ha par animal (partie 4, p. 215).
106Les grands propriétaires de Coalcomán n’ont jamais pu bénéficier des fameux « certificats d’inaffectabilité pour cause d’élevage », mais le statut reconnu à leur domaine de « petite propriété inaliénable » a suffi à les protéger. La fixation du « coefficient de pâturage » à 5 ha par tête permettait déjà de posséder 2 500 ha sans être inquiété (c’est la surface nécessaire au maintien de 500 bovins). La plupart des ranchos de la commune de Coalcomán sont d’ailleurs plus petits et légalement à l’abri de la Réforme agraire. En effet, les divisions successives des anciens domaines par héritage ont conduit à un relatif morcellement de la propriété. Beaucoup de propriétaires ne possèdent plus que quelques centaines d’hectares.
107Pour les paysans sans terre, la lutte devient donc de plus en plus ardue et les chances de réussite s’amenuisent un peu plus chaque année. Les propriétés susceptibles d’être redistribuées se font de plus en plus rares, leurs propriétaires les divisant artificiellement (sur le papier) entre les membres de la famille.
- 28 Loi fédérale de Réforme agraire de 1971, article no 196.
- 29 Idem note précédente, article no 195.
108Par ailleurs, la dispersion de l’habitat et le mode extensif de mise en valeur du milieu représentent autant d’obstacles supplémentaires à la prise en considération, par l’administration, des revendications agraires. La loi stipule en effet que les hameaux (nucleo de población) comprenant moins de vingt personnes habilitées à bénéficier de la Réforme agraire (chefs de famille ou veuves) ne peuvent prétendre à aucune « dotation agraire ». Leur représentation juridique n’est pas reconnue28. Pour être habilité à faire partie du groupe demandeur, chaque individu doit habiter dans le hameau en question depuis six mois au moins, avant de commencer les démarches administratives29. Toute procédure de dotation agraire est donc liée, au préalable, à l’existence d’un regroupement important de familles qui vivent et travaillent dans le même hameau. De tels regroupements étaient chose courante au début du siècle quand de nombreuses familles de métayers travaillaient chez le même propriétaire. Les transformations récentes du système agraire et la raréfaction de la main-d’œuvre ont provoqué, au contraire, la disparition de tels hameaux. Il est donc de plus en plus difficile de vivre assez nombreux au même endroit pour prétendre à une dotation foncière.
- 30 Archives de la SRA, Uruapan.
109Les familles doivent alors se regrouper sur la propriété « visée », y construire leurs maisons et obtenir le classement de « nouveau centre de population » (nuevo nucleo de población), avant de pouvoir se lancer dans la course d’obstacles des démarches administratives. Le nouveau village doit résister aux pressions qui s’exercent pour le faire disparaître, jusqu’à ce qu’un fonctionnaire du ministère de la Réforme agraire vienne constater son existence et recense ses habitants. Il faut ainsi résister des mois ou des années et il est en général impossible de travailler sur place (le propriétaire s’y oppose). Voilà pourquoi le seul groupe organisé de la commune, qui ait pu résister plusieurs dizaines d’années, est celui qui revendiquait les terres de la vallée de Coalcomán, dont les membres vivaient et travaillaient au bourg. Partout ailleurs, la lenteur administrative a peu à peu raison des groupes les plus déterminés. La dispersion des possibilités d’emplois et de survie provoque tôt ou tard l’éclatement du groupe et l’abandon du « nouveau village ». Il suffit alors au propriétaire menacé de convoquer un fonctionnaire pour que celui-ci constate l’inexistence du village ou sa trop petite taille (moins de vingt familles), afin d’annuler la demande et de classer l’affaire. Les volumineux dossiers conservés dans les archives du ministère de la Réforme agraire sont parfois remplis de rapports d’expertises et de contre-expertises discutant l’existence ou non d’un village ! C’est ainsi que sont rejetées les demandes des hameaux de La Limita, La Cofradia, Las Tabernas et Corral de Piedra. Dans le hameau de La Zanja, les maisons des solliciteurs sont même incendiées pour hâter la dispersion du groupe30. Aujourd'hui, il ne reste qu’un seul groupe revendicatif dans la commune de Coalcomán et ses constructions précaires sur le terrain « des pauvres » sont sans arrêt menacées par les raids des propriétaires de Coalcomán, soucieux d’en terminer avec les « empêcheurs de tourner en rond ».
110À l’exception des deux ejidos forestiers créés sur les hauts plateaux boisés de la commune, la lutte pour la terre se solde donc par un échec dans toute la Sierra de Coalcomán. Elle ne permet pas aux métayers de s’affranchir du propriétaire en devenant eux-mêmes « quasi-propriétaires » (ejidatarios). Non seulement le nombre de propriétés susceptibles d’être redistribuées diminue, mais les particularités du système de métayage ainsi que la dispersion de l’habitat et des possibilités d’emploi constituent autant d’obstacles aux luttes paysannes. Avec la division des propriétés par héritage, le nombre des propriétaires augmente tandis que celui des métayers tend à décroître. Même si le travail des métayers est encore indispensable pour l’implantation des prairies, leur poids relatif dans la société agraire de Coalcomán diminue beaucoup avec la spécialisation vers l’élevage extensif.
111Le rapport de force entre métayers et propriétaires favorise de plus en plus ces derniers (petits, moyens, ou grands). Seul un renversement de ce rapport de force aurait permis un réel partage de la terre. L’histoire récente des luttes agraires dans d’autres régions du Mexique montre qu’un tel partage est possible lorsque l’équilibre des pouvoirs bascule du côté de la paysannerie pauvre. C’est ce qui s’est passé récemment dans la région de la Huasteca quand la force du mouvement paysan et l’opposition des grands éleveurs aux projets d’irrigation, prônés par l’administration, ont provoqué la formation d’une alliance conjoncturelle État-paysannerie et le partage effectif des grands domaines d’élevage (Avila, 1981).
L’exploitation forestière absorbe une partie de la main-d’œuvre excédentaire
112Les hauts plateaux calcaires situés à l’est de la commune de Coalcomán sont encore recouverts de forêts de pins et leur exploitation continue est assez récente. Ces grands espaces (plus de 100 000 ha) n’ont pas été mis en valeur par les immigrés arrivés au début du siècle. Tous les ranchos situés autour des massifs forestiers possédaient leurs bois sur les plateaux, mais la plupart des activités agricoles et pastorales se déroulaient dans les vallées et sur les versants. Les bois de chênes furent progressivement abattus et mis en culture, ainsi que les pinèdes situées à proximité des hameaux. Au dessus de 1 800 m, et à l’exception des quelques dolines propices à la culture, les forêts furent sauvegardées. Le bétail les parcourait seulement à certaines époques de l’année (saison des pluies). Après la Révolution, les compagnies nord-américaines (Pacific Timber Company et Balsas Hardwood Company) abandonnèrent le terrain avant d’entreprendre de grandes coupes (fig. 10, p. 46).
113En 1954, une compagnie privée, La Michoacana de Occidente, obtient une concession d’exploitation d’une durée de vingt-cinq ans pour les neuf communes de la Sierra Madre del Sur. En échange de cette concession, la compagnie s’engage à réaliser des œuvres de « bénéfice social » : construire une route jusqu’à la côte, des écoles et des dispensaires (Arreola Cortes, 1980). La compagnie achète les arbres aux différents propriétaires, les coupe et transporte les troncs jusqu’à ses scieries de Varaloso et de Dos Aguas.
114Les nouveaux villages formés autour des scieries par les ouvriers de la compagnie sont rapidement étoffés par les métayers des ranchos concernés par l’exploitation forestière. Une demande officielle de dotation agraire est déposée pour les villages de Varaloso et de Barranca Seca. La rumeur de la création prochaine d’ejidos attire de nouveaux métayers en provenance de nombreuses propriétés de la commune. La « résolution présidentielle » de 1959 redistribue finalement 7 000 ha de forêts de pins à deux nouveaux ejidos : El Varaloso où 2 715 ha sont attribués collectivement à 155 bénéficiaires, Barranca Seca où 4 215 ha sont donnés à 280 bénéficiaires (annexe 6, p. 342 ; fig. 23, p. 130).
Tableau XII. Évolution de la population dans les villages « forestiers » de Varaloso et de Barranca Seca

Sources : recensements démographiques (annexe 1, p. 310).
115Mais les ejidatarios nouvellement dotés ne disposent d’aucun capital pour entreprendre l’exploitation de leurs forêts. Pendant plusieurs années, ils doivent vendre leurs arbres à la compagnie forestière qui bénéficie toujours de la concession d’exploitation et n’a pas été affectée par les distributions de terres. Les nouveaux ejidatarios restent ouvriers de la compagnie en travaillant à la scierie jusqu’en 1973. Cette année-là, la compagnie entreprend le démantèlement de ses scieries, car elle est accusée de n’avoir rempli aucun de ses engagements sociaux et menacée par le non-renouvellement de la concession.
116Les crédits accordés par l’État permettent aux ejidatarios d’acquérir (en commun) leur propre équipement et de connaître un processus d’enrichissement rapide. Le village de Varaloso installe sa scierie en 1979 et celui de Barranca Seca en 1981. Non seulement les nouvelles entreprises collectives (ejidales) donnent du travail à plus de 200 personnes, mais les bénéfices distribués aux membres de l’ejido permettent d’élever leur niveau de vie et d’augmenter leur capital. Dans 1’ejido de Varaloso, par exemple, les ejidatarios – désormais collectivement propriétaires du capital d’exploitation (scierie, camions, etc.) – investissent les bénéfices d’une campagne d’exploitation dans l’achat de 330 ha de terrain labourable dans la plaine des Terres Chaudes (Huisto, dans la commune de Aguililla). Pendant plusieurs années, les membres de Vejido sollicitent les autorités agraires pour obtenir l’expropriation de nouveaux terrains et une extension du domaine ejidal. Actuellement, de telles revendications n’existent plus, car tous les terrains privés qui entourent 1’ejido ont été peu à peu rachetés individuellement par les ejidatarios euxmêmes. Grâce à l’utilisation de prête-noms – car on ne peut être à la fois ejidatario et propriétaire-, beaucoup d’entre eux accèdent à la « propriété privée », sur les versants périphériques du plateau forestier exploité par 1’ejido. Ils deviennent éleveurs à l’endroit même où ils ont été métayers.
117Les anciens métayers devenus ejidatarios connaissent une accumulation particulièrement rapide au regard de leur ancienne situation. Mais cette évolution favorable ne concerne qu’un petit nombre de familles, bien inférieur à celui des bénéficiaires prévus par le ministère de la Réforme agraire. Comme dans de nombreux ejidos mexicains, en effet, le nombre de bénéficiaires potentiels annoncé – lors de la formation de l'ejido – est gonflé par le groupe demandeur (parents et amis sont invités à s’inscrire sur les listes et à appuyer de leur présence les réunions préparatoires). Quelques années après, les personnes qui ont effectivement bénéficié de la redistribution se révèlent souvent moins nombreuses. Certains membres, par ailleurs, ont abandonné leur droit ou l’ont vendu à d’autres personnes du groupe, d’autres ont été chassés par les conflits. Aujourd'hui, les membres effectifs de Vejido El Varaloso ne sont que 45 (contre 155 prévus initialement) et ceux de Barranca Seca sont 120 (contre 280 prévus officiellement). De nombreux travailleurs des forêts (employés à la coupe ou à la scierie) sont payés par Vejido sans être euxmêmes ejidatarios.
118La superficie forestière attribuée aux ejidos (7 000 ha) ne représente qu’un faible pourcentage de la surface communale recouverte de pins : environ 5 %. Même si de nombreux propriétaires privés vendent le bois de leur rancho aux ejidos, l’exploitation forestière est encore contrôlée, en majorité, par le secteur privé. Les plus grands propriétaires de forêt se sont également organisés pour exploiter eux-mêmes leurs ressources forestières et bénéficier des crédits gouvernementaux. Ainsi, 4 familles de Coalcomán, parmi les plus riches de la commune, ont formé avec neveux et enfants le groupe Madeco (qui compte 25 membres). Depuis 1980, ils contrôlent l’exploitation forestière de plus de 70 000 ha, grâce à leur scierie de Resumidero, la plus grande entreprise forestière de l’État du Michoacán. Elle emploie en 1980 plus de 240 travailleurs payés à la tâche pendant la saison de travail, du 1er novembre au 30 juillet.
- 31 Avec un potentiel de coupe de un million de mètres cubes de bois de pin, d’après les techniciens f (...)
119L’exploitation forestière devient donc une activité importante de la commune de Coalcomán. Les massifs forestiers de la Sierra Madre del Sur (celui de Coalcomán et ceux des communes voisines de Aguililla, Tumbiscatio et Arteaga) représentent 30 % des capacités forestières de l’État du Michoacán31. Mais le type d’exploitation des forêts de la région sud est très différent de celui pratiqué dans la moitié nord de l’État. Dans les massifs forestiers du nord du Michoacán, le pillage des forêts est généralisé : une multitude de petites entreprises plus ou moins légales abattent les forêts sans qu’aucun contrôle technique de l’opération ne soit possible. Près de 50 % des coupes s’opèrent clandestinement et les tronçonneuses fonctionnent surtout la nuit (abattant le « bois de lune »). Sur le plateau tarasque, et devant la crise de l’agriculture pluviale, la vente du bois est devenue la seule activité rémunératrice pour de nombreux paysans dépossédés (Linck, 1988 a).
120La situation est bien différente dans la Sierra de Coalcomán. La faible densité de population, l’isolement de la région et l’éloignement des centres urbains, gros consommateurs de bois coupé clandestinement, ont protégé la forêt. Depuis une dizaine d’années (depuis que la compagnie Michoacana de Occidentea cessé ses activités), l’administration qui prend en charge la gestion du patrimoine forestier contrôle entièrement les aspects techniques de l’exploitation forestière. Ainsi, toutes les entreprises forestières, privées ou ejidales, sont tenues de respecter les méthodes d’exploitation prônées par l’administration et de fournir aux techniciens forestiers la main-d’œuvre nécessaire au marquage et au comptage des arbres.
121La forêt est donc là mieux exploitée et mieux protégée que dans les massifs montagneux du nord de l’État. Il est désormais interdit d’abattre des pins à des fins agricoles ou pastorales sans autorisation délivrée par l’administration. Cette interdiction peut, bien sûr, être contournée par les éleveurs soucieux d’étendre la superficie de leurs pâturages (la surface de la commune rend impossible tout contrôle rigoureux), mais les revenus qu’ils peuvent espérer de la vente des arbres aux scieries les incitent à ne pas gaspiller ce capital, pour peu qu’une route forestière en autorise l’exploitation effective. La situation des forêts de pins de la commune paraît donc stabilisée après plus d’un siècle d’empiétements successifs, réalisés au profit des activités agropastorales. Seuls les incendies criminels réduisent encore la surface boisée car la valeur, récemment acquise, des forêts de pins les rend beaucoup plus sujettes aux vengeances et aux règlements de compte en tout genre. Les bois de chênes, qui couvraient de vastes versants de la Sierra de Coalcomán, sont par contre en voie de disparition. Premières victimes de l’installation des colons au début du siècle, ils ne sont pas efficacement protégés par l’administration forestière qui s’en désintéresse car leur valeur commerciale est faible.
- 32 Les emplois créés seraient au nombre de 1 075 en 1984 d’après le maire de la commune (Gobiemo muni (...)
122L’industrie de la forêt a donc créé de nombreux emplois dans la région de Coalcomán. Actuellement, les différentes scieries de la commune fournissent plus de 600 emplois pendant sept à huit mois de l’année (l’exploitation est interrompue en saison des pluies et les effectifs réduits)32. Les travailleurs du bois sont, pour la plupart, d’anciens métayers ou des fils de métayers attirés par des salaires relativement élevés (toujours supérieurs à ceux que peuvent espérer un journalier agricole). Malgré des conditions de travail pénibles et dangereuses, aucun d’entre eux n’a rebroussé chemin pour retourner travailler « à moitié » avec les éleveurs.
- 33 SPP, Mineria, 1984.
123D’autre emplois ont été créés, bien qu’en nombre beaucoup plus réduit, par le récent développement des activités minières. En 1983, la commune de Coalcomán produit 6 t d’argent, 250 t de plomb et surtout 65 000 t de baryte, soit près de 20 % de la production nationale33. Cette production est obtenue dans la mine de Los Encinos (au nordouest de la commune) qui constitue une véritable enclave minière. Contrairement au cas de l’exploitation forestière, cette activité échappe totalement aux habitants de la commune. Les capitaux investis sont d’origine étrangère (groupe Hylsa), sans aucun lien avec le capital local. Les emplois qualifiés sont occupés par des personnes extérieures à la région et peu de personnes originaires de la commune travaillent dans la mine (37 d’après le recensement de 1980 mais sans doute davantage aujourd’hui).
L’essor des cultures illicites
124Au moment où la région s’intègre à la division internationale du travail, cannabis et pavot sont bien les seules cultures pour lesquelles la Sierra de Coalcomán présente de réels avantages comparatifs. L’éloignement de la région, la complexité du relief, des précipitations suffisantes et les innombrables possibilités de camouflage sont alors autant de conditions favorables au développement de telles activités. Les pistes d’atterrissage, déjà aménagées dans la plupart des hameaux éloignés du bourg à l’époque du petit commerce aérien, facilitent la vente et le transport des produits récoltés.
125Le pavot, connu dans la région depuis très longtemps, était utilisé en médecine traditionnelle. Sa culture s’est beaucoup développée ces dernières années depuis que l’opium trouve des acheteurs, mais elle reste cependant limitée à certains affleurements calcaires, à l’abri des regards. Le développement de la culture du cannabis est beaucoup plus spectaculaire et concerne l’ensemble des régions montagneuses de la Sierra Madre del Sur. Elle s’est accélérée depuis quatre ou cinq ans, malgré la campagne de répression menée conjointement par les administrations nord-américaine et mexicaine.
126Ces cultures, de loin les plus rémunératrices, sont susceptibles de convaincre les plus réticents. La vente de 50 kg de cannabis rapporte autant que celle de 50 taurillons de 250 kg chacun. Elle représente un an de salaire dans les fermes de Californie et dix ans de travail pour un ouvrier agricole des campagnes mexicaines. En outre, la culture du cannabis demande très peu d’effort. Le semis s’effectue « à la lance », comme dans le cas du maïs sur brûlis. Désherbage et fertilisation (sulfate d’ammonium) sont facultatifs, mais leur usage tend à se répandre. Une fois la récolte achevée, la production est rassemblée sur l’aire de séchage (la cour de ferme ou les toits font en général l’affaire), puis remuée fréquemment jusqu’à obtention du degré hygrométrique souhaité par les acheteurs. Comme la production est abondante vers la fin de la saison des pluies, les prix proposés aux producteurs ont alors tendance à baisser. Pour obtenir une récolte plus précoce (au mois d’août) et bénéficier de prix plus avantageux, certains cultivateurs ont innové en développant l’utilisation de pépinières. Les graines sont alors semées (en pot ou dans des bacs aménagés) bien avant qu’il ne pleuve, puis arrosées. Les jeunes plantes sont ensuite transplantées, au début de la saison des pluies, dans les lieux de production. Il n’est pas rare d’observer un producteur récupérer avec soin les plantes qui ont germé sur son toit, où la récolte de l’année précédente avait séché.
127Quelques journées de travail suffisent donc à la production d’une importante quantité de plantes à stupéfiants, quelques heures seulement à la production de plusieurs dizaines de kilogrammes. Dans ces conditions, la rémunération du travail, extrêmement élevée, ne peut se comparer à celle d’aucune autre activité. Le prix offert aux producteurs de pavot est encore largement supérieur mais la récolte de la gomme, par incision et raclage quotidiens de la capsule, exige un travail minutieux, long et suivi, qui décourage de nombreux producteurs.
128Qui sème cannabis et pavot ? Et de telles cultures constituent-elles une solution réelle pour les paysans écartés de la sphère de la production par la spécialisation de la région dans l’élevage extensif ? On devine la difficulté d’enquêter sur de tels sujets comme le caractère décousu et aléatoire des informations recueillies. En première analyse, ces activités semblent accessibles à tous. Quand la culture des stupéfiants s’est développée dans la région de Coalcomán, il n’était pas difficile de se procurer les semences. Plusieurs personnes affirment que les soldats distribuaient les graines à qui voulait bien les semer. Pour ceux qui ne possédaient aucun terrain, le métayage était toujours possible, à moins de semer sans demander la permission au propriétaire.
- 34 Le cultivateur de plantes illicites risque de deux à huit années de prison s’il est « peu instruit (...)
129Depuis quelques années (1985), la répression s’est intensifiée et les conditions de culture ont quelque peu changé. Plante de soleil, le cannabis doit être semé dans des clairières ou en plein champ. Les hélicoptères le repèrent donc facilement et le détruisent à l’aide des rampes d’aspersion dont ils sont équipés. Le séchage de la récolte s’avère aussi très délicat, car il n’est pas toujours possible de dissimuler à temps la production lorsque les vrombissements d’hélicoptères se font entendre. Les producteurs ainsi surpris, ou même ceux uniquement soupçonnés, sont arrêtés et emprisonnés34, fréquemment frappés et soumis à de mauvais traitements. Leur maison est le plus souvent pillée, parfois brûlée. Partout, l’intensité de la répression conduit à des abus sans nombre et augmente encore la violence qui caractérise déjà cette société. Cultiver le cannabis devient donc une activité extrêmement dangereuse. Les quantités récoltées sont de plus en plus modestes, car les hélicoptères détruisent un grand nombre de parcelles. On ne peut désormais semer qu’en lisière de forêt ou dans les endroits les plus escarpés. Pour limiter les risques de ne rien récolter, les producteurs multiplient les lieux de production en ne semant que de très petites parcelles les plus dispersées possible. Disposer d’un très grand terrain – le plus abrupt qui soit – devient alors une condition nécessaire à la réussite.
130Malgré tout, la production n’a vraisemblablement pas diminué dans la région de Coalcomán. De notoriété publique, certains bénéficient de protections efficaces et peuvent ainsi semer de grandes superficies sans être inquiétés. Des journaliers sont même recrutés sur la place publique pour les travaux de désherbage, récolte, conditionnement et emballage. Le transport de la production s’effectue alors directement en avion, en hélicoptère (les mêmes que ceux utilisés pour la destruction des cultures ?) ou grâce aux camions blindés qui assurent les transports de fonds entre la banque de Coalcomán et sa succursale de Uruapan. Le caractère sélectif de la répression fait surgir un sentiment d’injustice et d’aucuns prétendent même – abusivement n’en doutons pas – que la campagne de répression qui s’abat sur les petits producteurs a pour but essentiel l’élimination de toute concurrence paysanne.
131Si l’on excepte le cas des personnes qui bénéficient de protections particulières, la culture des plantes interdites est donc une activité « à hauts risques ». Elle ne constitue pas un élément stable des systèmes de production. Le paysan qui sème est conscient des risques pris. S’il a de la chance, il dispose alors soudainement d’une quantité d’argent plus ou moins volumineuse qu’il faut dépenser promptement. Si la somme en question est modeste, elle sert à payer les dettes et à élever temporairement le niveau de vie de la famille : on achète des vêtements neufs, une paire de baskets neuves, un radiocassette, etc. Ces revenus « extra » constituent une bouffée d’oxygène passagère, mais il faut tenter le coup une nouvelle fois quelques années plus tard pour maintenir le niveau de vie ainsi atteint.
132Si la récolte est plus consistante et vendue sans encombre, la porte s’ouvre à un enrichissement instantané. Il est tout à coup possible d’acheter du bétail, une camionnette, de faire construire une maison au bourg et même d’acheter un rancho. Dès lors, continuer à prendre des risques en semant une nouvelle fois cannabis ou pavot n’est plus nécessaire. Les investissements réalisés suffisent à procurer des revenus très satisfaisants pour qui accepte de s’en contenter. Certaines familles pauvres – métayers, petits tenanciers – connaissent ainsi une phase d’accumulation fulgurante qui leur permet de devenir propriétaire-éleveur du jour au lendemain. Devenus indépendants, ils cessent alors de travailler « pour les autres ». De tels sauts qualitatifs dans l’échelle sociale de Coalcomán s’identifient aisément lorsqu’on s’intéresse, au cours des enquêtes, à l'évolution récente des exploitations agricoles. Le producteur cherche souvent à minimiser les progrès réalisés lorsqu’il les estime quelque peu suspects, mais la connaissance de l’histoire agraire de la région et des possibilités d’accumulation réservées à chaque type d’agent économique permet à l'enquêteur de lever le doute.
133Compte tenu de la répression, de telles réussites sont maintenant exceptionnelles. Les paysans qui sont restés soumis aux conditions du métayage n’ont plus accès aux cultures illicites. La plupart d’entre eux travaillent dans des propriétés relativement proches du bourg ou dans la vallée de Coalcomán, les ranchos les plus éloignés ayant été les premiers à se vider de leurs métayers. Si le patron n’est pas lui-même adepte de ce genre de cultures, le métayer n’a aucune chance de réussir son semis et il ne s’y risque pas en général. Les petits tenanciers, ceux qui ne possèdent que quelques dizaines d’hectares, n’ont guère plus de chance de réussite. La découverte d’une parcelle de cannabis si près de la maison d’habitation condamnerait automatiquement le père de famille et ses enfants en âge de travailler.
134Les seuls agriculteurs en position favorable sont ceux qui possèdent de grandes superficies très éloignées du bourg et inaccessibles en véhicule motorisé (on a le temps de voir venir les forces armées terrestres et de prendre la fuite). Très souvent, ces grandes propriétés sont désertées par les métayers depuis plusieurs années et la famille du propriétaire vit seule sur le domaine. C’est encore une famille élargie car les enfants adultes, mariés ou non, sont toujours là. On remarque dans de nombreux cas que seules les cultures illicites les ont retenus auprès de leurs parents, les dissuadant de partir aux États-Unis. Eux n’ont peur de rien et sont prêts à risquer le tout pour le tout pour « épater » les copains, jouir de la société de consommation, ou accumuler le capital et l’expérience nécessaires au mariage. Dès qu’ils le peuvent, ils font construire une maison à Coalcomán ; ils achètent la camionnette qui leur permettra de faire payer à leur tour les transports de personnes et de marchandises réalisés entre le bourg et les ranchos, la camionnette qui leur donnera la liberté d’échapper à tout moment à l’isolement de la propriété, même s’il reste du chemin à parcourir à pied entre la maison et le dernier chemin accessible en véhicule.
135De tels hameaux si isolés auraient perdu leur population jeune depuis longtemps si la culture des plantes à stupéfiants ne mettait pas un peu de sel dans la vie et d’argent dans la poche. En dehors des gros planteurs et trafiquants qui bénéficient de complicités évidentes, ces rancheros sont les seuls à pouvoir espérer tirer profit des cultures interdites.
136En injectant de grandes quantités d’argent frais dans l’économie de la région, les narcopesos, la culture et le trafic des plantes à stupéfiants ont créé de nombreuses distorsions. Les signes extérieurs de richesse donnent au bourg de Coalcomán et à certains hameaux des environs un aspect quelque peu irréel : voitures de luxe, antennes paraboliques, somptueuses villas, etc. La vie est chère à Coalcomán en regard de sa petite taille, les services et les commerces proposés sont ceux d’une ville de dimension supérieure. Des constructions disproportionnées surgissent çà et là sans autre motif apparent que celui de dépenser rapidement une grosse somme d’argent. La spéculation sur les biens immobiliers a provoqué une hausse considérable du prix des terrains urbains et des propriétés agricoles. Un producteur de cannabis ou d’opium qui vient de toucher le produit de sa récolte est prêt à acheter n’importe quoi à n’importe quel prix. Même les terrains les plus impropres aux activités agropastorales « traditionnelles » et les plus éloignés des voies de communication se vendent à des prix extrêmement élevés. Cette spéculation encourage donc la concentration foncière et met hors jeu les métayers et petits tenanciers qui voudraient placer leurs économies (quand ils en ont) dans l’achat d’une petite propriété. L’argent gagné honnêtement ne suffit plus à acheter un terrain.
137Les opportunités de gain et les salaires offerts aux journaliers de la drogue (5 à 10 fois supérieurs au salaire journalier normal) ont fait pression sur les salaires. Avec les autres possibilités de rémunération supérieure offertes par l’émigration, la drogue a aussi encouragé les travailleurs, métayers ou non, à abandonner le travail « classique » de la terre. Les grands propriétaires se plaignent tous des difficultés rencontrées pour trouver un métayer ou même un « gérant » qui accepte de travailler pour eux : « ils (les métayers) ne veulent plus travailler », se lamentent les propriétaires ; « ils veulent qu’on leur donne tout » (100 % de la récolte de grains). Il en est de même pour le travail salarié, bien que les salaires offerts soient très supérieurs à ceux proposés dans d’autres régions du Mexique : 8 000 à 10 000 pesos par jour en 1988 contre 6 000 pesos environ dans la vallée de Zamora, pourtant riche.
138Enfin, la culture et le trafic de la drogue ont accentué la distorsion sociale, constituée par la violence. Élément incontournable de l’histoire agraire de la région, les activités illégales l’ont augmentée. En plus de la violence des forces répressives, suspicions, dénonciations et vengeances sont encore plus nombreuses qu’auparavant. Les sommes d’argent mises en jeu sont considérables au regard du prix attribué à la vie d’un homme.
139Élément nouveau du système agraire, la culture du cannabis s’intègre parfaitement dans son évolution. Élevage extensif naisseur et culture du cannabis sont les deux activités pour lesquelles la Sierra de Coalcomán n'était pas trop mal placée dans le jeu de la spécialisation régionale. Leur développement relève aussi de la même logique : la recherche d’une augmentation de la productivité du travail et non d’une éventuelle augmentation des revenus à l’hectare. Paradoxalement, et pour la plupart de ses cultivateurs, le cannabis ne procure pas de hauts revenus par hectare car la surface semée, pour qu’on puisse un jour la récolter, doit être immergée, divisée et atomisée sur un très grand espace propice à son camouflage. C’est donc le contrôle de l’espace qui est à la base de la culture de cannabis comme à celle de l’élevage extensif. Son monopole permet le prélèvement de la rente, l’emploi d’une petite quantité de travail et l’obtention d’une productivité du travail très élevée.
140Notre hypothèse – elle relève plutôt de l’« intime conviction » – est que ces analogies entre élevage extensif et culture de cannabis expriment aussi une communauté d’intérêts entre grands éleveurs et narcotrafiquants. L’achat de grandes propriétés et de bétail représente sans doute un moyen aisé de blanchir l’argent illicite, surtout si ces transactions ont lieu dans un autre État de la Fédération. Plusieurs éleveurs de Coalcomán ont ainsi acheté des terres du côté du golfe du Mexique, dans les régions d’embouche. Ils ont organisé eux-mêmes le transfert de leur bétail maigre et son engraissement. L’un d’eux, installé à Tamuin, au cœur de la Huasteca, est devenu l’un des caciques les plus influents de cette commune, la première du Mexique en matière d’élevage bovin...
- 35 Contrairement aux idées souvent entretenues par la presse. D’après la revue hebdomadaire Proceso, (...)
141La culture du cannabis est de plus en plus réservée à une « élite » assez restreinte. Elle n’est plus accessible à la majorité de la population35. Les campagnes de lutte contre la drogue ont donc modifié sensiblement le profil « type » du cultivateur de plantes illicites : les producteurs de plantes à drogues ne sont pas toujours, ou ne sont plus, les paysans les plus nécessiteux, « faiblement instruits et dans une extrême nécessité économique ». Pourtant, l’extension des cultures illicites révèle d’abord un problème de développement agricole et, bien que les agriculteurs concernés ne soient pas toujours ceux que la crise frappe le plus durement, c’est bien de cette crise qu’il s’agit et des politiques agricoles définies jusqu’à présent : dévalorisation progressive des produits de l’agriculture vivrière, spécialisation régionale et ganaderización de vastes régions du tropique mexicain, inégalités foncières maintenues.
L’émigration
142L’essor de la culture des plantes à stupéfiants, pas plus que les nouveaux emplois offerts dans l’industrie forestière, n’ont réussi à compenser pleinement le large mouvement d’émigration, responsable du déclin démographique de Coalcomán enregistré après 1960. Plusieurs mouvements d’émigration sont responsables de cette hémorragie démographique. La Sierra de Coalcomán expulse dans trois directions : l’émigration aux États-Unis, caractéristique de toute la région occidentale du Mexique mais le plus souvent saisonnière, et l’émigration définitive, d’une part, vers l’État de Colima et, d’autre part, vers les communautés indiennes du sud (fig. 33).
L’émigration temporaire ou définitive vers les États-Unis
143Elle constitue un trait marquant de toute la région occidentale du Mexique. Ce n’est pas un phénomène récent : plusieurs vagues d’émigration se sont succédé depuis l’annexion, par les États-Unis, de la moitié nord du pays (1848). L’étape décisive de ce processus fut l’organisation officielle de l’émigration décidée par les deux pays en 1942 pour pallier les besoins urgents de l’économie de guerre nord-américaine. Mais le programme Bracero fut prolongé longtemps après la guerre puis clos en 1964. Cette période d’émigration planifiée permit à de nombreux Mexicains d'obtenir un visa de résidence permanente aux États-Unis et de constituer une population mexicaine importante et stabilisée de l’autre côté de la frontière. C’est sur la base de ces réseaux familiaux et villageois que l’émigration clandestine a pu se développer rapidement et durablement (Linck et al., 1986).
- 36 Depuis quelques années, de nombreuses études sont consacrées à l’émigration internationale, en par (...)
144Si l’émigration aux États-Unis caractérise tout l’ouest du Mexique, elle est particulièrement importante dans toutes les régions qui ont successivement attiré puis expulsé une partie de la paysannerie vers les terres moins peuplées du sud : Altos de Jalisco, Bajío, régions de Cotija et de Tocumbo, communes de Coalcomán, Aguililla et Villa Victoria36. Dans la commune de Coalcomán, l’émigration vers les États-Unis débute vraisemblablement dès 1950, mais ne se généralise qu’après 1960 pour les raisons explicitées plus haut. Elle commence donc beaucoup plus tardivement mais s’insère dans la même tradition historique. Elle concerne cette paysannerie créole ou métisse, constituée de petits tenanciers et de rancheros, de métayers et aussi, depuis la Réforme agraire, de très nombreux ejidatarios ou de leurs enfants journaliers agricoles. Il est frappant de constater que ce phénomène migratoire concerne moins la région indienne du plateau tarasque, pourtant entourée de régions pourvoyeuses de migrants. De même, l’émigration aux États-Unis est presque inconnue dans les communautés indiennes de la commune de Aquila.
145Aujourd’hui, elle est devenue un aspect important de la vie rurale à Coalcomán. Chaque année, décembre est l’époque du retour des saisonniers ; de longues files d’attente se forment devant la banque où chacun dépose ses économies. Si l’on excepte la culture et le trafic des plantes à stupéfiants, travailler dans les fermes de Californie (récolte des fruits en été) procure un revenu bien supérieur à celui que l’on peut espérer obtenir dans la commune de Coalcomán. Les salaires y sont dix fois supérieurs et un émigré peut économiser jusqu’à 400 ou 500 dollars par mois, s’il bénéficie d’un emploi stable qui lui permet de travailler tous les jours. Ainsi, plus de la moitié des producteurs interrogés est allée travailler aux États-Unis au moins une fois ou a des enfants saisonniers.
146L’émigration saisonnière reste compatible avec la poursuite du système de culture sur brûlis. Quel que soit l’objectif de l’agriculteur – produire plutôt du grain ou augmenter la surface en herbe – les plus gros travaux s’effectuent en hiver, à l’époque où les émigrés sont de retour au pays. Ils peuvent donc participer aux travaux de récolte (en janvier) et effectuer, au cours de l’hiver, l’abattis nécessaire au semis de l’année suivante. Quand ils repartent aux États-Unis (avril-mai), le gros du travail est fait : les émigrés laissent derrière eux une parcelle prête à être brûlée et ensemencée. Ces travaux, bien que délicats, demandent très peu de travail et sont facilement confiés aux parents ou aux frères qui ne partent pas. Pendant la saison des pluies, il reste à asperger la parcelle à l’herbicide Esteron et à répandre le sulfate d’ammonium au pied du maïs. C’est le seul travail nécessaire jusqu’au retour des émigrés l’hiver suivant. Le bétail est également confié aux membres de la famille qui n’émigrent pas.
147En revanche, il est impossible de mener de front l’émigration saisonnière d’été et le travail des terres à bœufs. La préparation du sol demande plusieurs semaines de travail au début de la saison des pluies. À l’époque où l’on pratiquait encore la succession pois chiche/maïs, l’implantation (en septembre) et le désherbage du pois chiche occupaient l’agriculteur une bonne partie de l’automne. Si la maladie cryptogamique du pois chiche et (abandon des terres labourées ont été à l’origine de nombreux départs, il est probable que l’émigration aux États-Unis a également précipité l’abandon de ce système de culture. Alors que la productivité du travail tendait à baisser en culture attelée, les perspectives de rémunération aux États-Unis et la possibilité de poursuivre la culture sur brûlis ne pouvaient qu’inciter les producteurs à délaisser les terres de labour.
148Les récentes études réalisées dans le nord-ouest du Michoacán tendent à prouver que l’émigration saisonnière ne concerne pas qu’un groupe social. Les émigrés sont souvent jeunes mais peuvent être fils de propriétaires privés, fils d’ejidatarios ou de journaliers agricoles, ou eux-mêmes propriétaires, ejidatarios ou journaliers. Dans la Sierra de Coalcomán, ce diagnostic peut être vérifié (propriétaires et métayers partent aux États-Unis) mais mérite d’être précisé.
149La décision de partir aux États-Unis suppose que l’agriculteur compare préalablement les revenus de son exploitation avec ceux qu’il pourrait obtenir de l’autre côté de la frontière. Pour que cette comparaison ait un sens, l’émigration aux États-Unis doit représenter une solution de rechange réelle, c’est-à-dire des chances de réussite suffisamment nombreuses. Pour envisager un tel départ, l’agriculteur doit disposer d’un capital minimal qui lui permette de financer le voyage, de payer les services d’un « coyote » pour passer clandestinement la frontière, et de survivre pendant les premiers jours aux États-Unis. Car le voyage de l’autre côté de la frontière est toujours une entreprise risquée et coûteuse. Ceux qui sont capturés par la police des frontières nord-américaine sont refoulés et perdent l’argent investi dans le voyage. Ils peuvent rester endettés longtemps, à moins de tenter une nouvelle fois le passage.
150Le candidat pour les États-Unis doit aussi disposer de contacts à la fois nécessaires à l’intégration dans la communauté émigrée et indispensables pour trouver du travail. Il doit déjà faire partie d’un réseau de relations familiales et de parrainage. Ceux qui ont de nombreux parents de l’autre côté, qui connaissent un « coyote » ou qui ont un parrain contremaître dans une ferme de Californie, augmentent leurs chances d’arriver à destination et de trouver rapidement du travail.
151Encore une fois, les métayers qui restent dépendants du propriétaire constituent le groupe le plus mal placé. Engagés pour établir les prairies temporaires, ils peuvent difficilement s’absenter avant d’avoir effectué les semis du mois de juin. En outre, ils disposent rarement des économies nécessaires au voyage. Parfois même, ils sont chargés de garder la propriété et de soigner le bétail du patron pendant que celui-ci part aux États-Unis.
152Parmi les 25 agriculteurs interrogés qui ont émigré, 9 anciens métayers ou fils de métayers ont réussi à acheter un terrain avec l’argent économisé aux États-Unis. Deux d'entre eux seulement ont pu acquérir une propriété de taille raisonnable (quelques centaines d’hectares), les autres étant devenus petits tenanciers. L’émigration a donc constitué, pour ceux-là, une source d’accumulation (exogène) remarquable, bien qu’on ne puisse pas toujours séparer clairement les rôles respectifs de l’émigration et de la culture ou du trafic de cannabis.
153Les plus aptes au départ semblent les jeunes dont les parents possèdent un rancho suffisamment grand pour que les enfants, mariés ou non, puissent s’y installer. Dans ce cas, il leur est facile de laisser provisoirement la parcelle de maïs et le bétail à la charge des membres de la famille qui n’émigrent pas et d'emprunter l’argent nécessaire au voyage. Le voyage est pour eux moins risqué, les risques encourus moins graves. Ils partent souvent célibataires et peuvent ainsi se constituer un petit capital facilitant leur installation dans le rancho de leurs parents et leur mariage : achat ou construction de la maison, achat d'une camionnette.
L’émigration vers les périmètres irrigués de l’État de Colima
154Lorsque, au début des années quarante, les villages situés au nord-ouest de la commune de Coalcomán furent dotés de terres, des métayers quittèrent les ranchos pour tenter leur chance comme ejidatarios (fig. 23, p. 130). À partir de 1950, la constitution de grands périmètres irrigués transforme le paysage agricole de l’État de Colima en introduisant l’arbre fruitier. Après 1970, l’irrigation connaît une phase d’expansion spectaculaire avec la maîtrise du Rio Armeria et l’irrigation prévue de 45 000 ha supplémentaires. Avec le développement des cultures fruitières de rente, le mouvement migratoire vers l’ouest s’intensifie, les métayers de Coalcomán franchissant les limites de la commune pour s’installer dans les villages de l’État de Colima.
155Il est facile d’y trouver du travail car l’arboriculture fournit du travail presque toute l’année pour la récolte des fruits. Mais les nouveaux venus s’inscrivent aussi sur les listes des demandeurs de terres, en attendant le jour espéré où l'ejido sera finalement créé. C’est ainsi que la population de l’État de Colima est gonflée par un flux ininterrompu d’immigrés venus des États de Jalisco et de Michoacán. En 1970, les immigrés sont 17 000 dans l’État de Colima. Ce sont surtout les zones irriguées qui bénéficient de ce flux migratoire : la population de Tecoman, situé au cœur du grand périmètre côtier, est multipliée par 8,2 entre 1940 et 1970 (Cochet, 1988).
156La pression sociale, exercée alors par les paysans, contraint le président Echeverria (1970-1976) à renouer avec une politique plus favorable à la paysannerie, politique quelque peu délaissée depuis les années quarante. De nouveaux ejidos sont créés et les anciens sont agrandis, mais les terres distribuées ne sont pas de bonne qualité : très peu de terrains irrigués et beaucoup de parcours montagneux peu productifs. Cette ultime phase de la Réforme agraire permet à de nombreux métayers de la Sierra de Coalcomán de devenir ejidatarios. Beaucoup restent journaliers agricoles, mais aucun d’entre eux ne retourne à Coalcomán. C’est vraisemblablement ce flux migratoire définitif, en direction des périmètres irrigués de Colima, qui participe le plus à l’hémorragie de main-d’œuvre survenue à Coalcomán à partir de 1960.
- 37 Nicolas Fornage (comm. pers.) confirme ce phénomène dans le cas du petit ejido de Cruz de Piedra c (...)
157Pour mesurer ce mouvement de population et en analyser les effets, il faut enquêter dans les villages de l’État de Colima. Dans la commune de Coquimatlán, les immigrés représentaient 20 % de la population en 1970. Parmi les 37 producteurs interrogés dans cette commune, 18 sont originaires de l’État de Jalisco et du sud-ouest de l’État de Michoacán (Cochet, 1988)37.
- 38 François Léger (comm. pers.). L’enquête a été réalisée auprès de 65 ejidatarios des ejidos Tecolap (...)
158Une étude récente réalisée dans le village de Tecolapa38 (commune de Ixtlahuacán, Colima) souligne l’importance des immigrés venus du Michoacán. Dans les quatre ejidos de ce village, 40 % des bénéficiaires de la Réforme agraire seraient originaires des communes de Coalcomán et de Villa Victoria, 6 % des communes de Coahuayana et de Aquila. Mais parmi les 28 immigrés interrogés dont on connaît l’ancienne activité, on distingue clairement deux groupes :
- le premier groupe (15 personnes) est formé d’anciens métayers. Ils se sont installés dans le village de Tecolapa dans les années soixante (certains dès 1951). Journaliers agricoles sur les périmètres irrigués, ils pouvaient également négocier avec les autorités ejidales ou les propriétaires privés la permission de semer une parcelle de maïs (sur brûlis) dans les montagnes qui dominent les zones irriguées (métayage ?). Après quelques années d’attente (plus de cinq ans en moyenne s’écoulaient depuis leur installation dans le village), ils sont devenus ejidatarios, à la faveur des créations successives d’ejidos, deux d’entre eux ayant acheté (illégalement) leur droit ejidal. Les parcelles dont ils jouissent actuellement ne bénéficient pas d’infrastructure d’irrigation et quatre d’entre eux n'ont accès qu’à des parcours montagneux non-labourables ;
- le deuxième groupe (13 personnes) est constitué d’anciens rancheros sans qu’il soit possible de préciser la taille de leur ancienne propriété. Leur descente de la Sierra de Coalcomán est plus tardive (1962-1979) et ne s’est pas réalisée dans les mêmes conditions. Douze ont acheté un ou plusieurs droits ejidales. Le délai moyen, écoulé entre leur descente de la Sierra et leur installation comme ejidatarios, se révèle beaucoup plus court : deux ans et demi en moyenne. La moitié d’entre eux (7) achètent leur droit l’année même de l'installation, peut-être même avant d’abandonner la Sierra de Coalcomán. Eux n’ont pas été chassés de leur région d’origine par la maladie du pois chiche, l’abandon des terres labourées ou le développement des prairies temporaires. Leur capital suffisait à l’achat immédiat d’un droit ejidal. Ils ont vraisemblablement fui leur rancho, à la suite de conflits sanglants et pour éviter des représailles. Car la violence endémique, caractéristique de la société agraire de Coalcomán, constitue aussi un facteur expulsif qui stimule toujours la mobilité démographique. Dans l’ensemble, ces immigrés possèdent de meilleurs terres. La moitié d’entre eux bénéficient des conditions favorables créées par les infrastructures d’irrigation39.
- 40 Léger (comm. pers.).
159L’arrivée de ce deuxième groupe d’immigrés aurait même perturbé l’organisation de l’espace ejidal en introduisant l’usage des clôtures et les pratiques d’élevage propres aux ranchos de la Sierra de Coalcomán. Il aurait provoqué un véritable phénomène d’enclosure40. Ces transformations sont comparables à celles imposées aux communautés indiennes de la côte du Michoacán par les agriculteurs-éleveurs de la commune de Coalcomán.
160La grande dépression des Terres Chaudes, qui sépare la Sierra de Coalcomán du centre du Mexique, connaît une évolution comparable à celle de l’État de Colima. Les barrages construits à l’initiative de la Commission du bassin du Tepalcatepec permettent la constitution de grands périmètres irrigués et le développement des cultures d’exportation. Beaucoup d’ejidos sont créés et la population de la vallée est pratiquement multipliée par quatre entre 1950 et 1970. Malgré cette évolution et la création de nombreux emplois saisonniers ou permanents, aucun flux migratoire massif en provenance de la Sierra de Coalcomán ne semble pouvoir être détecté. Certains métayers ou petits tenanciers se sont sûrement installés dans les ejidos de la commune de Tepalcatepec, mais la majorité des immigrés semblent plutôt originaires des régions situées au nord des Terres Chaudes (Duran Juarez et Bustin, 1983).
161Au sud-est de la Sierra de Coalcomán, un autre pôle de développement exerce une forte attraction sur la population du Michoacán. Il s’agit du complexe sidérurgique de Lazaro Cardenas mis en service au début des années soixante-dix. La construction d'un immense barrage sur le Rio Balsas, puis celle du complexe sidérurgique lui-même attirent plusieurs milliers de personnes vers le delta du Rio Balsas. Mais ces ouvriers ne sont pas originaires de la Sierra de Coalcomán. Parmi les agriculteurs interrogés dans les communes de Coalcomán, Aguililla, Villa Victoria et Aquila, très peu évoquent l’existence de ce pôle industriel pourtant si proche, mais quasiment ignoré. Les études démographiques réalisées sur l’origine géographique des ouvriers confirment ces résultats. Alors que d’importants contingents de migrants sont originaires des communes de Arteaga, de Lazaro Cardenas et de la vallée des Terres Chaudes, les communes de Coalcomán, Villa Victoria, Aquila et Coahuayana ne sont pratiquement pas représentées (Fourt, 1983).
L’émigration vers les indivis des communautés indiennes
162Cette migration lente vers la commune de Aquila et la réduction consécutive des communautés indiennes s’inscrivent dans le prolongement des mouvements de colonisation analysés dans les deux premières parties (p. 15 et 67).
163Les empiétements successifs réalisés au détriment des communautés indiennes, depuis l’installation à Coalcomán de la population blanche, sont brutalement stimulés par les transformations agraires survenues dans les ranchos de la Sierra de Coalcomán. Après l’abandon des terres de labour et devant la « savanisation » de l’écosystème, beaucoup de métayers et de petits tenanciers préfèrent tenter leur chance là où la terre est encore gratuite et non recouverte par les graminées fourragères : sur la fraction non envahie des indivis communautaires. Cette nouvelle phase du glissement démographique vers le sud est étudiée en prenant l’exemple de la communauté indienne de Pómaro.
LES TRANSFORMATIONS AGRAIRES DANS LES COMMUNAUTÉS INDIENNES : LE CAS DE PÓMARO
164Rien n’indique que les communautés indiennes de la commune de Aquila n’aient connu les transformations agraires mises en évidence pour les ranchos de la Sierra de Coalcomán. Les terres labourées étaient très peu nombreuses et le pois chiche n’intervenait pas dans le système de culture. Les effets d’une attaque éventuelle de maladies cryptogamiques sur les légumineuses ne peuvent donc être ressentis aussi durement, même si le haricot noir est effectivement touché. Si l’on en croit les quelques statistiques disponibles, la régression des activités agricoles ne serait pas aussi nette que dans la commune de Coalcomán (tabl. xiii).
Tableau XIII. Évolution de l’activité agricole dans la commune de Aquila 1950-1970
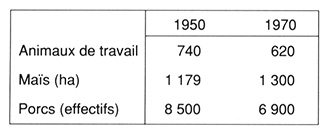
Sources : recensements agricoles de 1950 et 1970.
- 41 Les recensements agricoles de 1950, 1960 et 1970 donnent respectivement 8 300, 13 573 et 6 300 bov (...)
165De même, la transformation du troupeau bovin n’est pas aussi marquée dans les communautés indiennes, l’élevage conservant certains de ses aspects « traditionnels », antérieurs à la spécialisation de la région vers les activités naisseuses. Il suffit de parcourir les ravins humides de la côte en fin de saison sèche pour y observer de nombreux animaux « créoles » ou au phénotype encore peu marqué par le sang des races à viande (zébu). Ce bétail est encore moins bien recensé que dans la commune de Coalcomán ; on ne peut avancer aucune estimation sérieuse des effectifs de la commune41. Les exportations de bétail ne semblent pas dépasser les 3 000 têtes par an et ces ventes ne sont pas regroupées aux mois d’octobre et novembre comme dans le cas de la commune de Coalcomán. Les plus grosses ventes ont lieu pendant la saison sèche, de janvier à mai (annexe 8, p. 347).
166Enfin, l’évolution démographique de la commune est, elle aussi, très différente. Contrairement aux communes de la Sierra, la population augmente rapidement au rythme continu de 3,6 %/an entre 1950 et 1980 (fig. 34). À partir de 1970, la commune de Aquila redevient plus peuplée que celle de Coalcomán, comme c’était le cas avant que cette dernière ne soit occupée par les immigrés venus du nord. En 1980, la densité de population atteint 8,6 hab./km2 à Aquila contre 6,2 hab./km2 seulement pour la commune de Coalcomán. C’est surtout la population rurale qui croît car le bourg de Aquila, contrairement à Coalcomán, reste un village dont la population ne dépasse guère le millier d’habitants. L’écart enregistré dans les densités rurales est donc plus prononcé encore : 7,8 hab./km2 à Aquila contre 4 hab./km2 à Coalcomán.
167Cette croissance démographique est en partie due à la formation de nombreux villages sur la côte de la commune, où les épidémies et les fièvres des xvie et xviie siècles avaient décimé la population puis entraîné le regroupement des habitants dans les villages, installés en retrait ou surélevés, de Aquila, Maquili, Ostula, Pómaro et Coire. Les progrès réalisés en matière de santé publique et la lutte contre le paludisme permettent maintenant d’y vivre dans de meilleures conditions. À l’exception du village de La Placita, situé à l’ouest de la commune, la plupart des villages nouvellement créés sont peuplés d’indiens. Chassés de leurs terres par l’immigration de familles originaires de la commune de Coalcomán, ils sont descendus vers la frange côtière pour y fonder de nouveaux villages, non loin des emplacements choisis par leurs ancêtres. C’est ainsi que de 1960 à nos jours, la communauté indienne de Pómaro a subi un nouveau processus de spoliation.
Spoliations, enclosures et développement de l’élevage
Les spoliations foncières
- 42 Censo Agrario de 1960 (archives de la SRA). C’est le cas des familles Guillen, Zambrano et Cisnero
- 43 Assemblée extraordinaire du 11 septembre 1964 (archives de la SRA).
168La communauté indienne de Pómaro fut dépossédée à plusieurs reprises d’une partie de son territoire : la région orientale a été occupée dès la fin du xixe siècle (partie I, p. 15) ; la frange nord de la communauté fut envahie pendant et après la révolte des Cristeros (1927-1930) par de nouvelles familles blanches. Toute cette partie des indivis communautaires était donc truffée de petits hameaux fondés par ces familles de « gens de raison », mais les terrains occupés n’étaient pas clôturés. Plusieurs métis furent finalement acceptés par les autorités communautaires et considérés comme des membres à part entière du groupe. On les trouve inscrits sur la liste des membres de la communauté dressée en 196042. En 1964, la communauté indienne reconnaît un « droit d’ancienneté » à tous les immigrés installés depuis plusieurs décennies et à tous ceux nés sur son territoire. Elle leur accorde les mêmes droits et obligations, mais désormais « il est strictement interdit d’accepter dans aucun hameau une seule personne supplémentaire qui vienne d’ailleurs car il ne lui sera pas accordé un seul mètre de plus »43.
- 44 Enquêtes auprès de Daniel Betancourt et de Teodoro Cuevas. Correspondance échangée avec le Departa (...)
169Cette coexistence, relativement pacifique, est rompue dans les années soixante par l’arrivée d’une nouvelle vague de « gens de raison » en quête de terres. Malgré les menaces proférées par les autorités indiennes et leur « défenseur » Guillen (le « général » de la révolte des Cristeros), ces nouvelles familles refusent de payer le loyer qui est exigé d’elles et demandent la formation de plusieurs ejidos sur les terrains indivis. En remettant en cause les privilèges acquis par les Créoles « intégrés » à la communauté, les nouveaux venus déclenchent une guerre de clans qui ensanglante la région pendant plusieurs années44. C’est le contrôle des terrains indivis de Pómaro qui est en jeu. Comme les terrains communautaires sont protégés par la loi, aucun ejido n’est créé, mais la conquête des espaces communautaires continue quand le village indien de San Pedro Naranjestil est à son tour envahi.
170Cet ancien village fut repeuplé au début du siècle par essaimage du village de Pómaro. En 1950, il était encore décrit comme un « typique village mexicain indien avec ses toits en feuilles de palmiers », noyé dans une épaisse végétation tropicale (Brand, 1960). Le processus de domination progressive du village, semblable à celui déjà opéré dans les villages de Maquili, Aquila et Coire, est caractéristique.
- 45 Enquête auprès de Guadalupe Valencia (Ixtala) et Rafael Mendez (San Pedro Naranjestil).
171C’est souvent par le commerce muletier que les premiers contacts s’établissent. La curiosité, la nécessité, l’usure et les nouveaux besoins suscités par le commerce facilitent la constitution d’un réseau de relations de parrainage et de dépendance, qui permet l’intégration progressive du nouveau venu. Lorsque cet ensemble de relations est suffisamment dense, il est de plus en plus difficile de chasser l’intrus. Celui-ci peut alors obtenir des autorités indiennes, moyennant rémunération, la permission de construire sa maison et de monter un petit commerce au centre du village45.
172Les installations de familles étrangères au village se succèdent alors en cascade, le premier métis invitant sans tarder ses frères, cousins ou compères à l’imiter. Certains voient leurs constructions détruites par des commandos d’indiens irréductibles, mais les réseaux relationnels mis en place par les premiers arrivés, la corruption des autorités indiennes et les mariages mixtes facilitent les choses.
173Dès lors, la situation devient irréversible car un véritable quartier métis est créé, quand ce n’est pas tout le centre du village lui-même qui est occupé et ses anciens habitants refoulés à la périphérie. Aujourd’hui, le village de San Pedro Naranjestil a changé d’aspect : plusieurs dizaines de nouvelles maisons ont été construites. Elles sont disposées en blocs réguliers et alignés qui forment ainsi un quadrillage géométrique de véritables rues. Les maisons sont plus grandes, construites en briques crues (adobe) et munies d’un toit de tuiles ou de tôle ondulée. C’est le nouveau centre du village, tandis que l’ancien village indien se trouve maintenant excentré.
- 46 Enquête auprès de Santos Virrueta (El Aguacatito), Rafael Mendez et Maria Olascon (San Pedro Naran (...)
- 47 Traduit par nos soins.
174La création de la nouvelle paroisse de San Pedro Naranjestil (à la fin des années soixante) accélère le regroupement des familles blanches autour de l’église et ratifie l’existence du nouveau village. L’ancien village disposait déjà d’une chapelle et les familles créoles descendaient de leurs ranchos, disséminés dans les montagnes, pour assister à la messe à San Pedro Naranjestil46. Mais le curé les invitait à s’établir définitivement au village pour faciliter sa tâche spirituelle, contribuer à la construction de l’église et justifier la création d’une nouvelle paroisse. Depuis le xvie siècle, le regroupement des habitants autour de l’église et la construction de véritables villages constituent deux préoccupations essentielles de l’église catholique. C’est ainsi que fut organisée, peu de temps après la conquête, la réduction des villages indiens de Aquila, Maquili, Ostula, Pómaro et Coire (partie 1, p. 15). La construction, au début du xxe siècle, du village métis de Aquila relève exactement du même processus. Après avoir été chassé de Maquili en 1893, le curé est invité par les Indiens du village de Aquila à s’installer chez eux : « nous proposons des lots à un peso le mètre aux personnes qui souhaiteraient vivre ici, pour qu’un village se forme comme vous le désirez ». Après transfert de la paroisse à Aquila, le nouveau village prend corps : « La première chose que fit Monsieur le Curé en arrivant dans ce lieu fut de tracer la trame du village, aidé en cela par les quelques familles du lieu [...]. On dessina les rues, l’emplacement de l’église, celui des bureaux du gouvernement, de l’école et du jardin. Dirigés par Monsieur le Curé, les habitants de ce lieu commencèrent avec grand enthousiasme les travaux de ce qui allait devenir l’actuel village de Aquila [...]. C’est à cette époque [...] que sont arrivées plusieurs familles venant de Coalcomán, Villa Victoria et d’ailleurs qui, unies à la communauté indienne, invitèrent d’autres familles à s’installer et étendre ainsi le pueblo désiré par Monsieur le Curé. » (Cardenas, 1973)47. En 1970, la construction du nouveau village de San Pedro Naranjestil pourrait être racontée de la même manière. Elle s’achève par le réaménagement de la piste d’atterrissage qui facilite les échanges avec l’extérieur, en désenclavant le nouveau village.
- 48 SEP, Recensement scolaire, San Pedro Naranjestil, 1984.
175En 1984, les deux tiers de la population du village sont constitués par les « gens de raison »48. Contrairement aux familles installées depuis déjà longtemps dans les hameaux de la partie nord des indivis, les nouveaux arrivants ne sont pas encore « adoptés » ni inscrits sur la liste officielle des membres de la communauté. Aucun d’eux ne figure sur le dernier recensement agraire de 1976. Parmi les 23 familles interrogées dans ce village, 16 se trouvent ainsi en situation irrégulière. Pour tenter de redonner un peu d’importance à l’ancien centre du village, les autorités indiennes ont sollicité la participation des membres reconnus de la communauté pour y construire un marché. Ce local est exclusivement réservé aux marchandises produites et vendues par les membres légitimes du groupe. Mais cette tentative désespérée n’est pas en mesure de renverser l’équilibre des forces économiques qui a transféré le centre de gravité du village du côté de son extension récente.
Les enclosures
- 49 Compte rendu de l’assemblée communautaire du 25 février 1979 (archives de la SRA).
176Au-delà du processus d’occupation illégale des terrains indivis, c’est la généralisation de l’usage des fils de fer barbelés qui modifie le plus le paysage agricole. L’arrivée d’un nouveau contingent d’agriculteurs accélère l’abattage des forêts les plus proches du village et provoque une augmentation importante des surfaces emblavées chaque année. C’est sur ces espaces défrichés que les clôtures de barbelés gagnent progressivement du terrain, au grand dam des populations indiennes. En 1979, les autorités indiennes recensent 41 fractions indivises clôturées avec du fil de fer barbelé. 34 appartiennent à des métis et 7 à des membres indiens de la communauté49. Aujourd’hui, le terroir de San Pedro Naranjestil est entièrement clôturé, ainsi que l’ensemble du territoire contrôlé par les familles métisses.
177La nouvelle clôture en barbelés n’a rien de commun avec les clôtures déjà utilisées pour protéger le champs de maïs de la dent des animaux. Elle enferme désormais le bétail du propriétaire dans un espace soustrait à l’usage collectif, dont l’accès est interdit aux animaux des autres membres de la communauté. Ce n’est donc pas seulement un outil de gestion des pâturages comme dans le cas des ranchos de la commune de Coalcomán. C’est aussi un instrument d’appropriation privée de l’espace. La clôture en bois ne permettait qu’une protection passagère du maïs et sa fonction prenait fin après la récolte des épis. La nouvelle clôture au contraire est pratiquement imputrescible. En clôturant ces espaces communautaires, les métis transforment l’usu fruit temporaire en une sorte de droit d’usage pérennisé, incompatible avec toute forme de redistribution périodique des terres. Cet usage est maintenant définitif, personnel et exclusif : il s’apparente à une véritable propriété privée. La terre – dont l’unique valeur ne pouvait être mesurée que par le travail effectué – devient un bien accaparé par quelques familles et une marchandise.
178La transformation du terroir de San Pedro Naranjestil est représentée sur la figure 35 que l’on comparera avec la figure 21 (p. 112).
Le développement de l’élevage et la spécialisation régionale
179Lors des précédentes phases d’occupation des indivis communautaires, l’usage de la clôture ne s’était pas révélé indispensable. Au contraire, l’accès libre aux terrains des communautés indiennes et l’absence de clôture favorisaient la multiplication du bétail des éleveurs métis et leur enrichissement. Pourquoi donc la clôture devient-elle l’instrument principal des spoliations foncières ? C’est que la région côtière n’échappe pas au mouvement général de spécialisation régionale vers les activités d’élevage bovin naisseur. Les systèmes de production reposent désormais sur l'appropriation privée des ressources fourragères. Celle-ci ne pouvait être menée à bien sans une appropriation individuelle de l’espace et son morcellement en compartiments clos. Ce découpage du territoire et son appropriation privée n’empêchent d’ailleurs pas les éleveurs les plus puissants d’utiliser aussi les indivis encore libres de clôture (à proximité de la côte) pour y faire paître leur bétail.
180Après leur installation à San Pedro Naranjestil, les nouveaux venus développent des techniques d’élevage semblables à celles mises en œuvre dans la commune de Coalcomán : le bétail créole cède le pas aux animaux croisés avec les races zébu ; des prairies temporaires sont maintenant semées avec le maïs sur brûlis dès la première année. Il s’agit des graminées guinea (Panicum maximum) et buffet (Cenchrus ciliaris), mieux adaptées que le jaragua au-dessous de 800 m d’altitude. Les animaux produits sont des taurillons de un an et demi à deux ans. Les maquignons de la Huasteca ne venant pas toujours se ravitailler aussi loin, beaucoup de ventes se déroulent encore pendant la saison sèche. Les animaux sont surtout expédiés vers Colima et Ciudad Lazaro Cardenas.
181L’élevage devient pour tous les producteurs de la communauté de Pómaro – et pas seulement dans les zones envahies et clôturées par les métis – la seule activité rémunératrice. L’élevage caprin se développe aussi dans les zones encore peu clôturées (partie 4, p. 215) mais la plupart des autres activités régressent fortement, à l’exception de la culture et du trafic des plantes à stupéfiants. Le développement des voies de communication (route côtière, pistes et terrains d’aviation) et du commerce mettent pratiquement un terme aux productions locales de coton, tabac, canne à sucre et artisanats divers.
Conséquences des transformations agraires opérées sur les indivis
La désorganisation du système de production antérieur
- 50 Protestations formulées par les autorités communautaires en voyage à Mexico pour obtenir l’interve (...)
182On se souvient que le système de production pratiqué par les indiens accordait une place importante à la chasse et à la cueillette, ce qui ne contraignait pas chaque famille à semer beaucoup de maïs. Avant même que le terroir du village ne soit clôturé, l’accroissement démographique et l’augmentation des surfaces emblavées en maïs provoquèrent un intense défrichement, la destruction d’une partie des forêts primaires jusque-là préservées et le raccourcissement de la période de recrû. « Ceux qui se disent gens de raison coupent nos forêts à tort et à travers, sans aucune considération et sèment où bon leur semble. » « Pour pouvoir semer en terres primaires, ils abattent impitoyablement nos bois précieux. » « Ils ont exploité nos forêts à tel point que dans plusieurs endroits ça ne vaut plus le coup de semer parce qu’il n’y a plus de forêt neuve (primaire). » Malgré ces protestations répétées50 », les parcelles forestières propices au semis de maïs furent donc de moins en moins nombreuses et il fallait marcher chaque fois davantage pour découvrir, loin du village, une forêt d’âge raisonnable.
- 51 Compte rendu de l’assemblée communautaire du 25 février 1979 (archives de la SRA).
183Avec le développement des clôtures, des contraintes supplémentaires apparaissent. L’appropriation privée de l’espace ampute le domaine collectif et réduit encore l'espace où le choix de la parcelle à abattre peut s'exercer. Les clôtures entravent donc ce choix et interrompent le bon déroulement de la friche forestière. Même s’il dispose d’un petit périmètre clôturé par ses soins, l’agriculteur ne peut poursuivre la culture sur brûlis sans réduire considérablement la période de recrû forestier et compromettre les résultats de la culture. En 1979, l’assemblée des membres de la communauté demande la levée immédiate des clôtures et le respect du « libre usufruit des authentiques comuneros du lieu ». En échange, les autorités indiennes proposent d’« adopter » les métis qui accepteraient d’ôter leurs clôtures en les faisant membres à part entière de la communauté51, en vain.
184Enclosures et développement des prairies temporaires réduisent l’espace propice à la culture du maïs sur brûlis et, par là, son efficacité. Les anciens habitants du village et les métis qui arrivèrent trop tard se retrouvent donc dans des conditions fort semblables à celles qu’avaient dû affronter les métayers de la commune de Coalcomán : concurrence accrue des adventices et des graminées fourragères « associées » au maïs, diminution de la fertilité potentielle des terres et baisse des rendements.
- 52 D’après les agriculteurs interrogés, ceci se révélait impossible lorsque la parcelle abattue et br (...)
185Pour faire face à cette évolution défavorable des conditions de culture, les paysans modifient leurs pratiques. Afin de lutter contre le tapis herbacé, les agriculteurs sèment maintenant le maïs « en sec », c’est-à-dire avant le début de la saison des pluies. Ainsi, les graines peuvent germer dès que le sol s’humidifie avec les premières pluies, et le maïs prend moins de retard par rapport aux mauvaises herbes52. Depuis quelques années (1980), l’utilisation de l’herbicide Esteron s’est également répandue, mais celui-ci n’a aucun effet sur les graminées fourragères. Pour contrecarrer la baisse de fertilité du milieu, les agriculteurs commencent également à utiliser les engrais chimiques (sulfate d’ammonium) qu’ils répandent au pied de chaque poquet de maïs.
186Ces nouvelles pratiques culturales entraînent une augmentation importante des dépenses monétaires nécessaires à la culture. Herbicides et engrais coûtent cher, alors que l’ancien système de culture n’exigeait pratiquement aucune dépense monétaire. Elles provoquent aussi un accroissement du travail nécessaire : épandage de l’herbicide et des engrais, semis « en sec » plus difficile et plus lent car le sol n’est pas ameubli par les premières pluies. Cette dernière technique est plus risquée que le semis « mouillé » car la première pluie, qui déclenche la germination, peut être suivie de plusieurs jours sans pluies qui obligeront le producteur à semer une deuxième fois. Enfin, l'utilisation de plus en plus systématique des herbicides ne permet plus d’associer au maïs haricot noir et courge, comme cela se faisait fréquemment. Certains n’ont pas abandonné complètement ces cultures, mais doivent alors désherber le maïs à la main.
187La généralisation de nouvelles pratiques culturales permet donc le maintien de la culture du maïs sur les communaux qui sont défrichés, clôturés et parfois semés de graminées fourragères. Mais ce maintien n’est possible qu’au prix d’une importante baisse de la productivité du travail. Engrais et herbicides n’enrayent pas vraiment la baisse des rendements, car le risque climatique peut compromettre à tout moment les dépenses réalisées lors de l’acquisition de ces nouveaux intrants.
188Le développement des clôtures remet en cause la pratique de la vaine pâture. Avec ce système, les animaux profitaient des ressources fourragères de l’ensemble du territoire, selon les disponibilités de chaque saison. Les clôtures entravent désormais les déplacements des animaux, l’accès aux ressources fourragères étant maintenant déterminé par celui à l’espace. En outre, la plupart des points d’eau et des torrents se trouvent à l'intérieur des propriétés clôturées. C’est dans la fraction clôturée du territoire communautaire – celle où l’élevage est le plus développé – que l’on rencontre le plus de familles sans troupeaux. Beaucoup d’entre elles ont dû vendre leur petits troupeaux à ceux qui contrôlent maintenant les ressources fourragères.
189Enfin, l’appropriation privée des espaces collectifs ne permet plus à chaque famille un accès égal à chaque « étage écologique » du territoire et une exploitation diversifiée de ses ressources. Chaque unité de production a désormais accès à un espace limité aux ressources moins variées. La vulnérabilité des systèmes de production en est donc accrue, comme dans le cas des nouveaux villages indiens installés sur la côte.
190La mise en place de systèmes d’élevage, basés sur une appropriation privée de l’espace et des ressources fourragères, brise donc la reproductibilité du mode d’exploitation du milieu qui reposait sur la culture du maïs sur brûlis et la vaine pâture. Certaines formes de résistance développées par la communauté indienne permettent néanmoins d’en prolonger l’existence sur une partie du territoire communautaire.
Les formes de la résistance indienne
191Devant l’inefficacité des formes légales de lutte et des plaintes adressées aux autorités politiques, d’autres méthodes, plus efficaces, sont souvent utilisées, comme le bris de clôtures. Les éleveurs métis ne se contentent pas toujours des ressources fourragères accaparées et clôturées. Ils utilisent fréquemment les espaces encore libres de clôtures pour y faire paître leurs troupeaux, en particulier vers la mer, à proximité des nouveaux villages indiens. On voit alors des animaux dont les jarrets sont tranchés à la machette pour faire comprendre à leur propriétaire les limites de son droit de pâture ! Parfois même, l’animal est sacrifié et sa viande vendue sur la place du village.
192La meilleure façon de stopper la progression du « front des enclosures » aurait été, bien sûr, la construction d’une gigantesque clôture autour de la fraction non encore envahie des indivis communautaires. Mais l’édification d’une clôture est un travail coûteux et le manque de capital ne permet pas aux Indiens d’envisager une telle dépense. Cette expérience est cependant tentée par un groupe de comuneros du hameau de Los Encinos (situé à deux heures de marche de San Pedro Naranjestil), mais sur une courte distance : une chaîne de petites parcelles clôturées est installée du côté où le mouvement d’enclosure est le plus menaçant. En deçà du périmètre ainsi délimité, les habitants du hameau poursuivent la culture du maïs sur brûlis dans un espace non clôturé et encore soumis à la vaine pâture. La figure 36 illustre ce cas particulier.
Figure 36. Exemple de « stratégie anti-enclosures » dans la communauté de Pómaro : le hameau de Los Encinos.

193À proximité du village de San Pedro Naranjestil, sept habitants indiens du village réussissent également à clôturer collectivement une fraction de terrain, avant qu’elle ne soit accaparée par les familles métisses. Ce terrain sert en quelque sorte de réserve foncière qui permet de poursuivre, pendant quelques années, le semis de maïs sur brûlis.
194Ces expériences sont néanmoins limitées et la plupart des Indiens qui vivent encore à San Pedro Naranjestil deviennent journaliers agricoles ou métayers. Les métis arrivés trop tard sont dans la même situation. On les autorise à semer du maïs dans les lots clôturés, à condition d’y associer une graminée fourragère dont le bénéfice sera réservé au quasi-propriétaire métis. La plupart des anciens habitants du village choisissent plutôt de déménager pour s’installer sur le résidu de terrains indivis encore disponibles. Certains partent dans les hameaux indiens de Los Encinos, El Mirador et Cuirla suffisamment éloignés de San Pedro Naranjestil pour être momentanément à l’abri des clôtures. La majorité émigre vers la côte.
L’émigration vers la côte
195L’évolution démographique récente de la communauté de Pómaro est marquée par un glissement généralisé de la population vers la frange côtière. Tous les villages installés sur la côte ont moins de vingt ans d’âge, même si les sites correspondent souvent à ceux des villages préhispaniques. Cette migration est indienne mais le moteur du mouvement démographique se situe du côté des populations créoles qui, en progressant irrésistiblement vers le sud, repoussent la société indienne vers la mer. La migration a souvent été réalisée en deux étapes. La première voit la population des hameaux se concentrer dans les villages plus importants : San Pedro Naranjestil pour les métis et Pómaro pour les Indiens. La deuxième étape ne concerne pour l’instant que les populations indiennes ; elle consiste en l’installation définitive dans les villages côtiers. Les enquêtes réalisées dans les différents hameaux de la communauté de Pómaro ont permis d’identifier avec précision la trajectoire suivie par chaque famille (fig. 37).
- 53 Programme de constructions rurales réalisées dans les zones pauvres par Coplamar (Coordination gen (...)
196Les nouveaux villages de la côte ne ressemblent en rien à ceux dont la construction fut organisée autour de l’église, comme Aquila au début du siècle ou San Pedro Naranjestil très récemment. Les rues n’y sont pas tracées avec autant de rigueur ni les maisons alignées au cordeau. Les maisons sont souvent dispersées et l’espace collectif qui les sépare est parcouru par les animaux de tout le monde : vaches, chèvres, cochons, volailles, ânes et chevaux déambulent librement, sans qu’il soit réellement possible, pour le visiteur, de distinguer à qui appartient chaque animal. Dans le village de Maruata, les maisons en briques construites et alignées par les soins des institutions gouvernementales53 n’ont guère de succès et sont plutôt louées aux instituteurs.
197La construction de la route nationale côtière, qui relie maintenant Tecoman (État de Colima) au pôle sidérurgique de Lazaro Cardenas, est achevée en 1982. Le tronçon qui traverse la communauté indienne de Pómaro est terminé en dernier, alors que les villages côtiers sont déjà formés depuis une dizaine d’années. Ce n’est donc pas la construction de cette route qui a attiré les gens et provoqué la formation des villages de la côte. Elle fournit seulement quelques emplois temporaires à des membres de la communauté (cuisinière, manœuvre) déjà installés sur la côte et facilite la diversification des activités (petit commerce, pêche en mer, restaurant). En accélérant les transports, elle améliore aussi les allées et venues vers les périmètres irrigués de l’État de Colima.
198Les communautés indiennes voisines de Coire et de Ostula connaissent également des phénomènes d’enclosures mais ceux-ci sont moins spectaculaires. Bien que la communauté de Coire ait chassé les intrus après les massacres de 1936 (partie 2, p. 67), les villages de Estopila et de El Salitre de Estopila, situés au nord des terrains indivis, sont eux aussi entourés de clôtures, celles-ci progressant vers le sud.
- 54 Depuis l’installation dans la région de la communauté de Coire au xviie siècle, les conflits entre (...)
199Devant la réduction de l’espace disponible, beaucoup d’indiens descendent vers la côte. Le village de La Estanzuela, appartenant à l’ex-communauté indienne de Aquila, est occupé depuis longtemps par des familles métisses. La généralisation récente (1970-1980) des clôtures provoque le départ de tous ceux qui n’ont pas pu clore à temps et dont le système de production repose encore sur le maïs sur brûlis et la vaine pâture. Les conflits entre membres de la même communauté ou entre communautés voisines ?54 provoquent également nombre de déménagements. Toute installation sur des terrains situés plus au nord étant compromise par les enclosures, c’est aussi vers le sud qu’il faut partir.
200Ainsi, chaque communauté indienne dispose maintenant d’un ou plusieurs « villages annexes » sur la côte. Seule la communauté indienne de Huizontla, encerclée depuis près d’un siècle par les ranchos, voit son espace vital se réduire de jour en jour, sans disposer pour autant de « porte de sortie ». Le chapelet de villages indiens qui bordent la côte est limité au sud-est par le village de Guagua, déjà occupé depuis longtemps par les métis et marquant la limite orientale du terrain contrôlé par la communauté indienne de Pómaro. Il est limité au nord-ouest par le bourg de La Placita, construit sur les terres des anciennes communautés indiennes de Aquila et de Maquili. Moins enclavé que Aquila, il concentre les activités commerciales de la commune. La croissance démographique de ces villages est confirmée par les recensements démographiques, comme en témoigne le tableau xiv.
Tableau XIV. Croissance démographique des villages côtiers de la commune de Aquila 1930-1980

Sources : recensements démographiques (annexe 1, p. 310).
201Aujourd’hui, si le front de colonisation métis semble stabilisé, c’est que la communauté indienne de Pómaro s’est procuré des armes pour défendre le peu de terrain qui lui reste (environ 30 000 à 35 000 ha contre les 75 000 qui lui sont officiellement attribués). Les « gens de raison » ne s’aventurent guère dans les hameaux côtiers, à moins d’être nombreux et suffisamment bien armés.
Productivité et migrations
202Quand les agriculteurs indiens commencent à semer le maïs sur brûlis à proximité immédiate de la côte, ils ne rencontrent pas les mêmes contraintes agronomiques. Il ne s’agit pas de s’adapter à un raccourcissement de la période de recrû forestier, car ces terrains n’ont pratiquement jamais été travaillés. Sur des photos aériennes prises en 1971, on distingue nettement les premières parcelles de maïs sur brûlis aménagées dans la forêt tropicale caducifoliée encore presque intacte. Il faut par contre affronter un climat plus sec et une saison des pluies écourtée aux deux extrémités (partie 2, p. 67). Sur la côte, la variabilité interannuelle est très élevée : entre 1980 et 1985, les précipitations enregistrées à la nouvelle station climatologique de Cachán varient de 280 à 1 220 mm et la longueur de la saison des pluies de 98 à 137 jours. Pendant ces six années d’observation, la fin du mois de juillet et le début du mois d’août sont marqués par une forte diminution des précipitations (c’est le phénomène de la « canicule »). Pendant deux ou trois semaines, l’évaporation potentielle est nettement supérieure au niveau de précipitations enregistré (fig. 38).
Figure 38. Répartition par décade des précipitations enregistrées pendant la saison des pluies à Cachán.

Source : station climatologique de Cachán. Moyenne établie sur six années d'observation 1979-1984. Les données concernant l'évaporation sont celles mesurées sur un bac d'eau libre.
203Plus que jamais, c’est le « calage » du cycle du maïs par rapport à la saison des pluies qui détermine les chances de succès de la culture. L’adoption de variétés plus précoces (90 jours) aurait peut-être permis une meilleure adaptation de la culture aux conditions climatiques, mais c’est une variété semi-précoce (120 jours) qui a le plus de succès auprès des agriculteurs. Il s’agit du maïs hibrido (encore appelé H.507), largement semé dans l’État voisin de Colima et de plus en plus utilisé dans la communauté de Pómaro, y compris sur les terrains clôturés de la partie nord en dessous de 800 m d’altitude. Le succès de ce nouveau maïs est largement dû à sa taille, encore relativement grande, qui garantit une bonne récolte de fourrages (tiges et feuilles) pour le bétail. Par ailleurs, bien qu’hybride ce maïs peut être resemé plusieurs années consécutives car la dégénérescence est lente ; les épis commencent à s’atrophier seulement deux ou trois années après. Il n’est donc pas nécessaire de débourser chaque année l’argent nécessaire à l’achat des semences.
204Sur la côte, on peut difficilement semer « en sec » pour allonger la période utile au maïs. Les premières pluies provoquant la germination du maïs sont trop souvent suivies d’un « arrière-goût » de saison sèche qui détruirait le semis. Il faut attendre que le sol soit suffisamment humidifié pour commencer à semer.
205Enfin, la période de relative sécheresse qui interrompt presque systématiquement la saison de pluies représente un risque grave pour le maïs, car la floraison a toute chance d’avoir lieu à ce moment. Les agriculteurs peuvent être tentés de retarder les semis pour limiter ce risque, mais c’est la dernière partie du cycle qui serait alors compromise par la fin de la saison des pluies. Les paysans considèrent en général que l’année commence bien quand les pluies débutent à la mi-juin et qu’il est possible de semer pour le jour de la Saint-Jean (soit plus d’un mois après les semis dans la Sierra de Coalcomán). Entre 1979 et 1985, ce ne fut possible qu’une seule fois.
206Bien que les forêts de la frange côtière soient entamées très tardivement, les conditions de la culture du maïs n’y sont guère favorables. À proximité des nouveaux villages de la côte, on observe déjà une tendance à la diminution de la période de recrû et au semis de graminées fourragères. Les facteurs limitants mis en évidence dans la Sierra s’ajoutent alors à ceux propres à la frange côtière.
207En abattant pour la première fois les forêts tropicales de la côte, les Indiens exploitent des terres de plus en plus marginales. Malgré ce gradient continu de productivité décroissante depuis le sud de la commune de Coalcomán jusqu’à la côte, l’espoir des métayers de conserver la totalité de la récolte motive l’émigration vers le sud et l’installation sur les indivis communautaires (partie 2, p. 67). La récolte y est parfois plus faible mais on n’est pas obligé de la partager avec le patron. Néanmoins, ce gradient décroissant de la productivité du travail limite nécessairement l’ampleur du phénomène, car les terres ainsi conquises sont de qualité toujours plus médiocre. Pourquoi observe-t-on alors cette nouvelle phase brutale de progression des populations métisses vers le sud et le rejet consécutif des populations autochtones sur la frange côtière ? Et qui sont les nouveaux envahisseurs ?
208Beaucoup étaient métayers ou petits tenanciers dans la commune de Coalcomán. On a vu comment ils avaient abandonné le travail « à moitié » dans les ranchos, à la suite de la crise du système de culture attelée, de la concurrence imposée au maïs par les graminées fourragères et de la dégradation consécutive des conditions de culture du maïs sur brûlis. D’autres étaient déjà installés sur les terrains communautaires et profitaient depuis plusieurs années de la vaine pâture.
209Aucun d’entre eux n’était propriétaire foncier à son arrivée sur les terrains indivis. Mais la faible marge d’accumulation dont ils disposaient en travaillant comme métayer à Coalcomán suffisait pour disposer d’un petit capital de départ indispensable. En vendant un cochon ou un veau, ils pouvaient acheter un lopin « urbain » à San Pedro Naranjestil, profiter d’un terrain illimité et gratuit, jouir de la totalité de la récolte et acheter le plus rapidement possible quelques rouleaux de fil de fer barbelé. Ce capital préalable, si petit soit-il, dépassait largement celui des familles indigènes dont le système de production reposait encore sur le maïs sur brûlis, la vaine pâture, la chasse et la cueillette. Un siècle avant, les immigrés originaires de Cotija n’étaient pas eux-mêmes grands propriétaires lorsqu’ils prirent possession des terrains de la communauté indienne de Coalcomán. Ils devinrent puissants en disposant d’un terrain qui ne leur coûtait rien. Leur capacité d’accumulation s’en trouvait ainsi démultipliée, tout en conservant le même système technique d’exploitation.
210La spécialisation de la Sierra de Coalcomán dans l’élevage naisseur relance donc la réduction des communautés indiennes opérée par les travailleurs qu’elle expulse. Les conditions d’accumulation différentielle du capital permettent aux exclus de Coalcomán de développer à leur tour des systèmes d’élevage sur les indivis communautaires envahis. L’intégration de la région aux échanges marchands et la nouvelle division régionale du travail ne leur donnent d’ailleurs aucun autre choix : élevage extensif parfois complété par la culture des plantes à stupéfiants.
211Dans ces conditions, la productivité décroissante du travail sur le maïs n’a plus guère d’importance. Elle ne constitue plus aucun frein à la progression du front de colonisation. Désormais, seul l’espace compte et son contrôle fixe les possibilités de développement de l’élevage extensif et des cultures illicites. Quand le climat est plus sec, les conditions de développement des prairies temporaires sont mauvaises mais la conquête des ravins boisés de la région côtière, riches en arbres fourragers, compense alors ce handicap.
212Ce sont donc bien les transformations agraires observées dans les ranchos de la Sierra de Coalcomán et la spécialisation progressive de la région qui provoquent la reprise du glissement démographique vers le sud et la réduction des communautés indiennes. Les derniers terrains encore indivis et contrôlés par les membres indiens des communautés sont ceux qui disposent des conditions naturelles les moins favorables. Ils correspondent approximativement aux régions semi-arides de la côte aux sols granitiques sableux et fort peu propices à l’élevage. Les communautés de Ostula, Coire et Pómaro se disputent le massif granitique côtier. Celle de Huizontla ne contrôle plus qu’une petite partie de son ancien territoire, celle qui s’étend sur des affleurements granitiques aux sols squelettiques (fig. 12, p. 70).
CONCLUSION : PÂTURAGES, MÉTAYAGE ET DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLEVAGE EXTENSIF EN AMÉRIQUE LATINE
213Le développement de l’élevage extensif a été particulièrement rapide dans la plupart des pays d’Amérique latine pendant ces dernières décennies. Les voyages que nous avons eu l’occasion d’effectuer dans les régions tropicales humides du golfe du Mexique (principale zone d’embouche au Mexique), dans la péninsule du Yucatan (région de Tizimin), dans la péninsule du Guanacaste (Costa Rica) et sur les fronts pionniers des régions de Guatusos (Costa Rica) et de Matagalpa oriental (Nicaragua) nous ont permis de constater que le développement spectaculaire de l’élevage dans ces régions relevait des mêmes mécanismes économiques que dans la Sierra de Coalcomán. De même, les rapports sociaux mis en œuvre (métayage, défrichement de la forêt et préparation des prairies effectués gratuitement par les semeurs de maïs, etc.) sont très comparables à ceux que nous venons d’étudier en détail.
- 55 Ramirez Moreno et Rosenfeld B. (1983) : l’étude concerne l’État de Tabasco au sud-est du Mexique. V (...)
- 56 C’est parfois ainsi que sont traités les paysans sans terres (precaristas) du Costa Rica lorsqu’il (...)
214C’est dans les zones de « frontière agricole » des régions tropicales humides que les phénomènes observés sont les plus spectaculaires. En première ligne, les paysans pauvres et sans terre font reculer la lisière de la forêt en y semant leur maïs en « défriche-brûlis » ou même grâce à la technique encore plus simple de la « défriche-pourrissage ». Après une ou deux années de culture, le paysan défricheur doit rendre à son propriétaire la parcelle prêtée, parcelle dont la valeur foncière a été multipliée par le travail du « métayer ». Les paysans sont donc talonnés par les propriétaires-éleveurs qui les refoulent dès que la forêt est remplacée par la prairie. La transformation de l’écosystème forestier en une sorte de savane est extrêmement rapide (quelques années seulement) et le « front » avance de plusieurs kilomètres par an. Lorsque les paysans sont déjà installés depuis longtemps et pratiquent la culture sur brûlis à friche de longue durée, la rotation forestière s’accélère peu à peu sous la pression de l’élevage. Les rendements baissent ; les maladies et parasites en tout genre amputent encore la production vivrière qui régresse rapidement. Le cultivateur, principal exécutant de la défriche et de l’amélioration des pâturages, est progressivement évincé car son espace de survie s’amenuise de jour en jour55. S’il ne se hâte pas de démonter sa maison pour la reconstruire dans un nouveau hameau de défrichement, celle-ci est parfois incendiée par ceux pour lesquels l’utilisation du nouveau pâturage n’attend pas, surtout si sa présence représente une menace pour la reconnaissance du régime foncier en vigueur56.
215Parfois encore, le paysan défricheur est lui même propriétaire de sa parcelle. Il n’est plus métayer ni même ancien métayer. Sa relation avec le détenteur de capital (le grand éleveur) devient une sorte de contrat de travail où l’agriculteur devient salarié sur sa propre terre (Fernandez Ortiz et Tarrio, S. d.). Il peut aussi vendre son herbe, c’est-à-dire louer ses pâturages – en général à faible prix – à ceux qui ont du bétail, car lui n’a aucun capital.
216Dans tous les pays du bassin amazonien, de tels phénomènes ont également été observés (Costa Barbosa Ferreira, 1986 ; Léna, 1986). Quand l’efficacité des paysans défricheurs ne suffit plus à la tâche, ils sont définitivement expulsés et remplacés par les bulldozers ou les défoliants (Eglin et Théry, 1982).
217Dans certaines régions tropicales moins humides et plus anciennement peuplées, la progression des prairies temporaires au détriment des produits vivriers cultivés sur brûlis est moins spectaculaire et souvent moins rapide, mais les rapports sociaux entre éleveurs et paysans-semeurs d’herbe sont toujours à peu près les mêmes. Ainsi, dans l’État du Yucatan, les pâturages empiètent progressivement sur la région traditionnelle de culture du maïs sur brûlis pratiquée par les agriculteurs mayas. Ceux-ci restent propriétaires ou usufruitiers (ejidatarios) de leurs parcelles, mais les ventes d’herbe se multiplient car le retard enregistré dans l’accumulation du capital ne leur permet pas d’avoir leur propre troupeau.
- 57 Enquêtes réalisées dans la région de Nicoya avec Paul Sfez, février 1986.
218Dans la péninsule de Guanacaste, au Costa Rica, certains membres de l’ancienne communauté indienne de Matambu doivent louer leurs pâturages aux propriétaires-éleveurs des alentours, après les avoir eux-mêmes améliorés et clôturés. Devant la « savanisation » de l’écosystème – beaucoup plus précoce et radicale que dans la Sierra de Coalcomán – les petits producteurs de maïs et de haricot ont de plus en plus de difficultés à trouver un espace propice à la défriche-brûlis ou à la défriche-pourrissage. Les moins pauvres d’entre eux réussissent à acheter un araire, puis une charrue, afin de lutter contre l’invasion (dès 1960) de l’écosystème cultivé par le jaragua. Mais les autres, ne disposant pas des outils nécessaires, doivent émigrer vers le sud, où la pression foncière plus faible et l’élevage moins développé ont permis la conservation de grands lambeaux de forêt. Quand l’écosystème forestier disparaît complètement, les paysans sans terres émigrent une nouvelle fois. Mais ils doivent aller beaucoup plus loin, vers la frontière agricole du nord-est, pour défricher un nouveau lopin de terre et y implanter une prairie de graminées pour le compte du propriétaire57.
219La transcendance de ce phénomène et ses conséquences économiques et sociales dans les sociétés latino-américaines d’aujourd’hui sont telles qu’elles justifieraient la multiplication des comparaisons. Il est probable que le développement de l’élevage extensif et des rapports sociaux de production qui lui sont associés pour l’implantation et l’entretien des pâturages ne soient pas exclusivement réservés aux grands domaines latino-américains. Dans la Sierra Andaluza (Espagne), dont les structures agraires sont restées marquées par la très grande propriété, le nettoyage des pâturages s’effectuait aussi par la culture périodique jusqu’en 1960. Celle-ci était confiée aux paysans sans terre qui devaient, de surcroît, payer une rente équivalente à 10 % de la récolte obtenue (Roux, 1975).
220Même si le développement de cet élevage extensif se réalise dans un contexte de grandes inégalités foncières (ce sont elles qui rendent possible un tel développement), il serait faux de penser que l’opposition éleveur/agriculteur se calque toujours sur celle de latifundium/paysan sans terre. Sans que le pouvoir politique des grands éleveurs soit remis en question, l’élevage est une activité désormais généralisée à tous les producteurs, petits et grands, des régions d’élevage. L’élevage est au centre de gravité de la plupart des systèmes de production. En général, il en constituait déjà un élément indispensable (culture attelée). Mais la division régionale du travail et la « savanisation » de l’écosystème font progressivement de l’élevage extensif la seule activité encore rentable, la seule qui permette au producteur de maintenir ou d’augmenter la rémunération de son travail, à condition que celui-ci ait les moyens d’acquérir le bétail et les clôtures.
- 58 Plusieurs situations analogues sont décrites dans Hubert Cochet et al. (1988). Le développement de (...)
221Dans certaines régions du Mexique, le développement de l’élevage extensif est d’abord un phénomène intra-ejidal, intimement lié à la différenciation paysanne à l’intérieur de la « communauté ejidal ». Bien souvent, le groupe dominant profite des pâtures de l’ensemble de 1’ejido par le jeu combiné de l’appropriation des espaces indivis, des locations de parcelles et des « ventes » d’herbe. Il n’est pas rare non plus que les autorités du groupe ejidal louent les pâturages communautaires à des éleveurs extérieurs à la communauté58.
222Pour les grands éleveurs capitalistes, il est d’ailleurs indispensable que les petits et moyens agriculteurs se spécialisent eux aussi dans l’élevage (Ramirez Moreno et Rosenfeld, 1983). De véritables poches d’élevage naisseur surgissent ainsi dans les zones où les petites structures d’exploitation (privées ou ejidales) dominent le panorama foncier. Les grands éleveurs, ainsi débarrassés de la phase délicate de la reproduction, achètent le bétail maigre et organisent le transfert des animaux vers leurs domaines spécialisés dans les activités d’embouche. Dans la Sierra de Coalcomán, les bénéfices réalisés au cours des activités d’engraissement échappent, pour la plupart, aux éleveurs de Coalcomán car les zones d’embouche sont trop éloignées. Certains d’entre eux délaissent pourtant l’élevage naisseur et acquièrent de grandes propriétés dans les régions d’embouche pour se consacrer à l’engraissement (partie 4, p. 215).
223Le développement de l’élevage extensif et la spécialisation de l’ancien métayer, ou petit producteur, vers les activités d’implantation et d’entretien des pâturages sont donc des phénomènes généralisés à d’immenses régions d’Amérique latine. On attribue souvent à cette paysannerie les défrichements spectaculaires dont sont victimes les grands massifs forestiers du continent, alors que le développement de l’élevage extensif en est, de toute évidence, responsable.
224Ce rapide survol du continent permet également de relativiser et de mieux comprendre la situation observée dans la Sierra de Coalcomán. La « savanisation » de l’écosystème n’y est pas encore achevée et la progression des prairies temporaires au détriment de la forêt est beaucoup plus lente que dans les régions tropicales humides en voie de colonisation. Le « front de savanisation » n’apparaît pas aussi net que dans les forêts de la façade atlantique centre-américaine (mais il avance quand même vers la côte !). La progression des prairies temporaires au détriment de la forêt et du maïs sur brûlis se réalise plutôt à l’intérieur de chaque rancho et par petites touches successives. Enfin, tous les producteurs participent à ce mouvement général, y compris les Indiens de la côte pacifique.
225On a souvent perçu le développement de l’élevage extensif comme une sorte de retour en arrière technologique et les grands éleveurs qui s’y adonnent comme les derniers représentants d'un système « semi-féodal ». Ces appréciations ne semblent pas correspondre à la réalité. Car on pourrait tout aussi bien considérer l’élevage extensif comme une spécialisation fort bien adaptée à la division internationale du travail et conditionnée par cette dernière. Il autorise en tout cas une productivité du travail parfois très élevée, et largement supérieure à celle des autres activités « traditionnelles » de la région dans laquelle il se développe.
226L’élevage extensif exige très peu de main-d’œuvre et caractérise souvent les régions de frontière agricole. Dans les régions plus anciennement peuplées, comme la Sierra de Coalcomán, il représente une forme d’adaptation du système agraire à une raréfaction de la main d’œuvre. Il accélère aussi l’exode des métayers et des petits tenanciers, en réduisant sans cesse l’espace propice à l’agriculture de subsistance sur brûlis.
Notes
1 D’après les recensements agricoles de 1950, 1960 et 1970, les rendements moyens obtenus dans la commune de Coalcomán (tous systèmes de culture confondus) sont respectivement de 810, 780 et 825 kg de grain par hectare.
2 En 1960, six millions de porcs sont recensés au Mexique. Ils sont près de 10 millions en 1970 et 20 millions en 1983 (Inegi-Inah, 1986).
3 Dans son Informe de 1947, le président de la République déclare : « Pour dédommager les ejidatarios et agriculteurs qui ont perdu leurs animaux à cause de l’épizootie, 287 tracteurs et 26 000 mules ont été achetés [aux États-Unis]. » (Tarrio Garcia, 1985).
4 Il passe de 200 000 à 104 000 d’après les recensements agricoles de 1950 et 1960 (État de Guanajuato).
5 Enquête auprès de Luis Gonzalez Zepeda (Cotija).
6 Voir Francisco Perez Gil, 1892 : tableau 45.
7 Enquête auprès de Renauld Arizabalo, (Tempoal, Veracruz).
8 Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán, 1954 et 1958.
9 Leurs noms correspondent à ceux des éleveurs « d’avant-garde » qui apparaissent dans le rapport d’activité de 1958 de la Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán.
10 Moyenne établie sur sept années (1981-1987) d’après les informations disponibles à l'Asociacion Ganadera de Coalcomán. Au niveau de l’État du Michoacán, 33 % seulement des ventes ont lieu entre septembre et novembre. Le mois d’octobre ne concentre que 11,5 % des ventes d’après les données rassemblées par Inifap (1986).
11 Sur ce thème, voir Hubert Cochet et al., 0988) et Thierry Linck 0988 b).
12 Mazoyer, notes de cours (s. d.).
13 L’Union des éleveurs de Coalcomán en recommande le semis dès 1958 (Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán, 1958).
14 Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán (1958), Gobiemo municipal de Coalcomán (1984, 1985), Asociacion Ganadera Local de Coalcomán : réponse à la circulaire no 008, 10 juin 1987. Les recensements agricoles de 1960 et 1970 avancent les chiffres de 7 855 et 17 000 respectivement. Ils nous paraissent grossièrement sous-estimés.
15 Ces estimations sont proposées par Boudet (1975). Les estimations de la production sont données pour Hyparrhenia diplandra.
16 Pour des repousses de deux mois, l’équivalence serait de 0,55 UF/kg MS pour Hyparrhenia rufa (ministère de la Coopération, 1980).
17 On admet qu’une vache et son veau consomment environ 5 UF/j, soit 10 kg MS.
18 Voir les travaux récents de François Léger (comm. pers.) dans l’État de Colima, Mexique.
19 Anagsa (Aseguradora nacional agricola y ganadera).
20 Une évolution assez semblable des contrats de métayage est décrite par Esteban Barragan (1990) pour la Sierra de Tocumbo.
21 Archives de la SRA, Uruapan (annexe 6, p. 342). La situation est semblable dans la commune de Villa Victoria où de nombreuses demandes ont été rejetées.
22 Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán, 1954.
23 Ligue de la petite propriété agricole de Coalcomán, 1958.
24 Ce type de discours est représenté par le travail de Pedro Saucedo Montemayor (1984).
25 Cet aspect de la loi est modifié dans la nouvelle loi fédérale de Réforme agraire de 1971.
26 La peur d’une éventuelle affectation est toujours la raison invoquée par les éleveurs pour justifier un bas niveau d’investissement et le maintien de systèmes extensifs.
27 L’indice de agostadero mesure le nombre d’hectares nécessaires à l’entretien d’une tête de bétail. C’est, au sens mathématique, l’inverse de la capacité de charge en bétail.
28 Loi fédérale de Réforme agraire de 1971, article no 196.
29 Idem note précédente, article no 195.
30 Archives de la SRA, Uruapan.
31 Avec un potentiel de coupe de un million de mètres cubes de bois de pin, d’après les techniciens forestiers.
32 Les emplois créés seraient au nombre de 1 075 en 1984 d’après le maire de la commune (Gobiemo municipal de Coalcomán, 1984). Ce chiffre nous semble quelque peu surestimé.
33 SPP, Mineria, 1984.
34 Le cultivateur de plantes illicites risque de deux à huit années de prison s’il est « peu instruit et dans une extrême nécessité économique », mais de huit à quinze années d’emprisonnement dans tout autre cas (article 196 du code pénal). Le président Salinas de Gortari a cependant annoncé un durcissement des peines.
35 Contrairement aux idées souvent entretenues par la presse. D’après la revue hebdomadaire Proceso, par exemple, la totalité de la population de la commune voisine de Aguililla participerait à la culture du cannabis et du pavot (no 599, 25 avril 1988).
36 Depuis quelques années, de nombreuses études sont consacrées à l’émigration internationale, en particulier pour les régions situées au nordouest du Michoacán. Plusieurs d’entre elles sont rassemblées par Thomas Calvo et Gustavo Lopez (1988), Gustavo Lopez et Sergio Pardo (1988). Pour la région sud-ouest du Michoacán, l’émigration vers les États-Unis est étudiée dans la commune de Aguililla par Roger Rouse (1988).
37 Nicolas Fornage (comm. pers.) confirme ce phénomène dans le cas du petit ejido de Cruz de Piedra créé en 1976 : il y rencontre 10 ejidatarios originaires des communes de Coalcomán et de Villa Victoria installés dans l’État de Colima depuis 1958 (pour les plus anciennement installés).
38 François Léger (comm. pers.). L’enquête a été réalisée auprès de 65 ejidatarios des ejidos Tecolapa, La Salada. P. Carranza et F. Gallardo.
39 D’après les données rassemblées par François Léger (annexe 9, p. 349).
40 Léger (comm. pers.).
41 Les recensements agricoles de 1950, 1960 et 1970 donnent respectivement 8 300, 13 573 et 6 300 bovins pour la commune de Aquila. Ces données nous semblent fortement sous-évaluées.
42 Censo Agrario de 1960 (archives de la SRA). C’est le cas des familles Guillen, Zambrano et Cisnero.
43 Assemblée extraordinaire du 11 septembre 1964 (archives de la SRA).
44 Enquêtes auprès de Daniel Betancourt et de Teodoro Cuevas. Correspondance échangée avec le Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizacion, lettres du 25 juillet 1961, 14 décembre 1961 et 2 février 1962 (archives de la SRA).
45 Enquête auprès de Guadalupe Valencia (Ixtala) et Rafael Mendez (San Pedro Naranjestil).
46 Enquête auprès de Santos Virrueta (El Aguacatito), Rafael Mendez et Maria Olascon (San Pedro Naranjestil).
47 Traduit par nos soins.
48 SEP, Recensement scolaire, San Pedro Naranjestil, 1984.
49 Compte rendu de l’assemblée communautaire du 25 février 1979 (archives de la SRA).
50 Protestations formulées par les autorités communautaires en voyage à Mexico pour obtenir l’intervention du président de la République : lettre au président Luis Echeverria du 19 mars 1972 et lettre au gouverneur Carlos Galvez Betancourt (non datée), archives de la SRA (traduit par nos soins).
51 Compte rendu de l’assemblée communautaire du 25 février 1979 (archives de la SRA).
52 D’après les agriculteurs interrogés, ceci se révélait impossible lorsque la parcelle abattue et brûlée était une forêt bien reconstituée. Après le brûlis, la terre était « trop chaude » pour y semer le maïs avant les premières pluies. En outre, un maïs semé de cette façon aurait eu une croissance trop rapide pendant les premières semaines (forte minéralisation de la matière organique) et n'aurait pas résisté à la verse.
53 Programme de constructions rurales réalisées dans les zones pauvres par Coplamar (Coordination general delplan nacional de zonas deprimidas y grupos marginados).
54 Depuis l’installation dans la région de la communauté de Coire au xviie siècle, les conflits entre celle-ci et les communautés voisines de Pómaro et de Ostula n’ont pas cessé (annexe 2, p. 326).
55 Ramirez Moreno et Rosenfeld B. (1983) : l’étude concerne l’État de Tabasco au sud-est du Mexique. Voir également Luis Fernandez Ortiz et Maria Tarrio (s. d., 1983), Bernard Roux (1973), Agustin Avila et Cervantes (1986), Rodolfo Lobato (1979).
56 C’est parfois ainsi que sont traités les paysans sans terres (precaristas) du Costa Rica lorsqu’ils s’installent sur le front pionnier du nord-est, dans la région des Guatusos, comme nous avons pu le vérifier à l’occasion d’un voyage effectué en 1986 dans la région avec Paul Sfez.
57 Enquêtes réalisées dans la région de Nicoya avec Paul Sfez, février 1986.
58 Plusieurs situations analogues sont décrites dans Hubert Cochet et al. (1988). Le développement de l’élevage extensif dans la Selva Lacandona (État de Chiapas, dans le sud du pays) n’est pas dû aux seuls grands éleveurs « capitalistes ». Il se développe également à l’intérieur de chaque ejido nouvellement créé pour les colons. Enquête auprès de R. de la Torre, Mexico. Agustin Avila (1981) mentionne également le développement de l’élevage dans les ejidos de la Huasteca, grâce aux contrats de location et/ou de métayage.
Table des illustrations
 | |
|---|---|
| Titre | Tableau VII. Rendements et productivité du travail pour la culture du maïs après abandon du pois chiche |
| Légende | * Les quantités sont rapportées à la surface concernée par la « rotation » jachère/maïs (2 ha). |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-1.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 35k |
 | |
| Titre | Tableau VIII. Régression de la culture attelée dans la commune de Coalcomán 1950-1970 |
| Légende | Sources : recensements agricoles de 1950 et 1970.* Tous systèmes de culture confondus (culture attelée et sur brûlis).** Union des éleveurs de Coalcomán, chiffre avancé pour 1987.*** SARH, Distrito de Desarollo Rural no 083, Aguililla, moyenne 1980-1985. |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-2.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 26k |
 | |
| Titre | Tableau IX. Évolution de la production de maïs et de porcs gras dans la commune de Coalcomán 1950-1970 |
| Légende | Sources : recensements agricoles de 1950 et 1970. |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-3.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 30k |
 | |
| Titre | Figure 25. Évolution comparée du prix (en pesos) de la viande de porc et du saindoux à Mexico (1927-1970). |
| Légende | Source : d'après les données de Inegi-lnah (1986) (voir annexe 7). |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-4.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 40k |
 | |
| Titre | Figure 26. Destinations des ventes de taurillons de la commune de Coalcomán (1986-87). |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-5.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 76k |
 | |
| Titre | Figure 27. Destinations principales des ventes de taurillons de la commune de Coalcomán et régions d’embouche. |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-6.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 84k |
 | |
| Titre | Figure 28. Ventes mensuelles de béta hors de la commune de Coalcomán (1981-1987) |
| Légende | Source : voir annexe 8. |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-7.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 47k |
 | |
| Titre | Figure 29. Répartition par sexe des ventes de bétail hors de la commune de Coalcomán en 1987. |
| Légende | Source : voir annexe 8. |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-8.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 43k |
 | |
| Titre | Figure 30. Évolution comparée de l'indice général des prix et de l’indice du prix de la viande bovine (1927-1977) (indice 100 en 1927). |
| Légende | Source : d'après les données de Igeni-lnah (1986) (voir annexe 7). |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-9.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 101k |
 | |
| Titre | Figure 31. Représentation schématique de l'évolution de la culture sur brûlis dans la commune de Coalcomán. |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-10.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 86k |
 | |
| Titre | Tableau X. Estimation de la production fourragère consommable de la culture sur brûlis dans l’ancienne et la nouvelle rotation (UF/ha) |
| Légende | (Lorsqu’une telle rotation est adoptée depuis plusieurs années, l’agriculteur dispose chaque année de n ha de prairie âgée de 1 an + n ha de prairie âgée de 2 ans + n ha de prairie âgée de 3 ans, etc.). |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-11.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 83k |
 | |
| Titre | Figure 32. Urbanisation et exode dans la commune de Coalcomán (1950-1980). |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-12.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 53k |
 | |
| Titre | Tableau XI. Évolution de la population dans quelques hameaux de la commune de Coalcomán 1921-1985 |
| Légende | Sources : recensements de population. Pour 1985, les données sont issues des recensements scolaires réalisés par les instituteurs (annexe 1, p. 310). |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-13.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 61k |
 | |
| Titre | Tableau XII. Évolution de la population dans les villages « forestiers » de Varaloso et de Barranca Seca |
| Légende | Sources : recensements démographiques (annexe 1, p. 310). |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-14.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 27k |
 | |
| Titre | Figure 33. Émigration dans la Sierra de Coalcomán. |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-15.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 56k |
 | |
| Titre | Tableau XIII. Évolution de l’activité agricole dans la commune de Aquila 1950-1970 |
| Légende | Sources : recensements agricoles de 1950 et 1970. |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-16.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 25k |
 | |
| Titre | Figure 34. Évolution démographique comparée des communes de Coalcomán et de Aquila (1930-1980). |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-17.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 51k |
 | |
| Titre | Figure 35. Enclosures à San Pedro Naranjestil : schéma de l'organisation de l'espace en 1980. |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-18.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 216k |
 | |
| Titre | Figure 36. Exemple de « stratégie anti-enclosures » dans la communauté de Pómaro : le hameau de Los Encinos. |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-19.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 103k |
 | |
| Titre | Figure 37. Enclosures et migrations dans la communauté indienne de Pómaro (1960-1980). |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-20.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 171k |
 | |
| Titre | Tableau XIV. Croissance démographique des villages côtiers de la commune de Aquila 1930-1980 |
| Légende | Sources : recensements démographiques (annexe 1, p. 310). |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-21.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 61k |
 | |
| Titre | Figure 38. Répartition par décade des précipitations enregistrées pendant la saison des pluies à Cachán. |
| Légende | Source : station climatologique de Cachán. Moyenne établie sur six années d'observation 1979-1984. Les données concernant l'évaporation sont celles mesurées sur un bac d'eau libre. |
| URL | http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/14745/img-22.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 59k |
Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.









